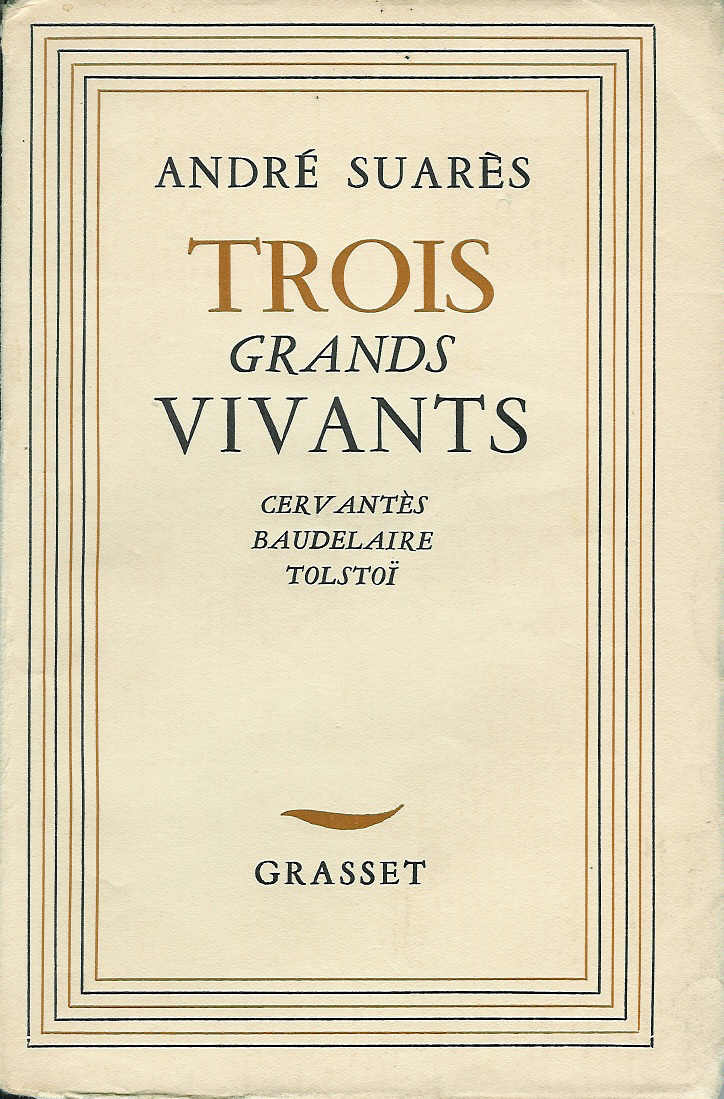I
PEU SONT À SON RANG, NUL AU-DESSUS
He had few equals, and no superiors.
Le 10 septembre, Tolstoï a eu soixante-dix ans. Le monde se fût honoré, en faisant de celui-là son jour de fête. Chaque époque a son héros : Tolstoï est celui de la nôtre ; car il est le plus humain de tous les hommes. Pour isolé soit-il, pour peu compris qu’il puisse être, il n’est pas moins le seul homme, où presque tous puissent reconnaître quelque chose de soi, et le seul qui pour chacun ait quelque chose. Une paysanne, un idiot, et même, pour ainsi dire, un chien, une bête, un humble animal, ont quelque lien avec lui, comme Napoléon, une âme d’acier ou un esprit de prince. Le cœur de Tolstoï, et son imagination, sont l’espace le plus vaste qu’il y ait, aujourd’hui, dans le monde ; et ce vieillard est le seul exemple qui nous ait été donné d’une vie sublime. Que sa vieillesse puissante nous est chère : elle est encore la plus belle œuvre d’un poète, à qui l’on en doit de si grandes ; elle est un témoignage merveilleux du cœur en faveur de l’esprit. Celui qui pouvait vivre de gloire n’a plus voulu vivre que de charité. Et celui à qui le génie eût dû suffire n’a pu se contenter à moins de l’amour parfait. Ainsi l’homme, qui était allé le plus loin dans la connaissance des autres, n’a pas désespéré de l’humanité ; mais, au contraire, il y a guéri les doutes conçus de soi-même. C’est le plus beau triomphe de l’imagination. Il ne sera pas dit qu’elle tue le cœur sous elle, car plutôt elle le ressuscite. Médiocre, elle ruine son homme, et le réduit à la misère, en le forçant à lui tout tourner en pâture, pour la soutenir. Mais, grande et vive, qu’elle est féconde ! En tout, l’essentiel est d’avoir beaucoup plus d’imagination que les autres, et de connaître quel abîme sépare la médiocrité de la plénitude. Il est admirable, enfin, que le même homme ait fait voir qu’il lui a dû d’être l’un des premiers parmi les saints, après avoir été un des premiers entre les artistes.
Qu’elle est touchante la vieillesse consacrée par un grand homme à la sainteté : même débile et presque déchue, au déclin de l’intelligence, elle nous touche. Combien ne nous ravit-elle pas, quand elle est robuste, verte, riche en action, pleine d’œuvres ? Aucun homme ne fait plus honneur à l’homme que Tolstoï. Il est sublime avec simplicité : point d’effort ; c’est l’élan de sa nature qui le porte. Peut-être y en a-t-il eu de plus profonde : de plus large, de plus vaste, il n’en fut pas. Cette nature d’homme est à l’image de son pays : elle n’a ni montagnes perdues dans les nuées, ni océans en tempête, ni profonds abîmes. Mais son horizon est immense, son étendue semble infinie ; toute la terre s’y déroule d’un seul tenant ; et tout le peuple humain y trouve place, mêlé aux autres êtres vivants.
L’incertitude des pensées, ou l’entêtement dans quelques-unes, — peu de vieillards y échappent. La solidité logique est la marque de la vigueur et la santé de l’esprit. Avec les années, Tolstoï semble croître en certitude ; et même il gagne en souplesse. Il n’a rien écrit de plus rigoureux que son dernier ouvrage sur l’Art ; et de tous les objets à définir, c’est le plus fuyant, et peut-être le plus difficile. Comme ces fortes épaules sur ce large dos, cet esprit est propre à porter toute sorte de charges. Telle en est l’assiette, qu’il ne penche jamais plus du côté où naturellement il incline, qu’il ne s’écarte de celui où il ne veut pas aller. Tolstoï ne se défend pas seulement de suivre son inclination : il se préserve de croire qu’on ne la suit pas assez. Quelle force dans un apôtre, qui, sur de sa vérité, passionné pour y gagner les autres hommes, ni ne se flatte de faire sur eux une pêche miraculeuse, — ni surtout ne se plaint de ne rien prendre dans ses filets. En pareil cas, il est plus beau de ne pas se croire sans action que de se flatter d’en avoir une irrésistible.
Tolstoï ne désespère point. Il n’est pas de ces enthousiastes qui se nourrissent d’espérances. Sa vie est triste. Mais il a Dieu pour lui. Il pense que le jour du Seigneur ne peut manquer de venir. Il a cette force incalculable d’une foi qui parle à la raison des hommes. Comme on ne l’eût pu convaincre en dehors d’elle, il s’assure qu’il la convaincra tôt ou tard en eux. Il ne fait pas grand fond sur ceux de son temps : il se détourne des hommes âgés ; il ne prétend rien sur ces pécheurs envieillis. Il recherche les jeunes gens, les âmes fraîches, les cœurs simples.
Tolstoï humilie de trop près ses voisins, ses parents, ses proches. Un homme si puissant est difficile à vivre : on ne peut l’accepter qu’en l’aimant. L’amour semble une servitude à des âmes trop petites. On croit garder son indépendance, en l’armant contre lui. On ne voit point que se débattre contre la tyrannie d’une force supérieure, ce n’est pas moins graviter dans son orbite. Sa vie est triste, dès qu’il la sépare de son Dieu et de son peuple. Elle ne lui serait, sans doute, pas supportable, sans la passion qui l’anime. Et enfin, sa plus belle récompense de s’être créé un monde, est qu’il y peut vivre.
II
SUR UNE IDÉE ÉPICURIENNE ET ÉVANGÉLIQUE DE LA VIE
Tolstoï ne raisonne jamais sur des idées pures ; il les ramène toutes à des faits. Sa religion est impossible à entendre, si on la sort du fait. La théorie n’est à ses yeux que l’ensemble de la pratique. Il n’est pas facile d’en repousser les conséquences. Au temps où j’ai cru en lui, il ne me paraissait pas possible de faire son salut sans cultiver la terre. L’idée fondamentale de Tolstoï est celle de l’Évangile : Jésus montre de petits enfants à ses disciples, et il leur dit : « Soyez pareils à ces petits, si vous voulez entrer dans le Royaume des Cieux. »
— Pour Jésus, comme pour tous les Anciens, et pour Tolstoï même, le Royaume des Cieux, c’est la vie heureuse. Pour être heureux, il faut être comme de petits enfants. Jésus est le Dieu d’un peuple d’enfants passionnés, qui met une violence de feu à vouloir cette vie heureuse, — et ne l’a jamais crue impossible un seul moment. Ce peuple même est mort avec son Dieu, — je dis ceux qui l’ont crucifié ; et n’a vécu qu’en lui ressuscité, — je dis ceux qui l’ont cru dérobé au ciel, le troisième jour. Pour ceux-ci, l’idéal et la vie se pénétraient continûment. Passionnés pour le ciel, ils ne quittaient jamais la terre : leur volonté mystique et leurs combats réels ne faisaient qu’un. C’est pourquoi Jésus ne pouvait être le Christ et le Messie que dans cette race-là ; et il fallait qu’il fût le Dieu des Juifs avant d’être celui du monde. Plus tard, on l’a fait métaphysicien chez les Grecs ; César éternel à Rome ; enfin, prêcheur du libre droit de la conscience chez les Saxons. Mais s’il était possible d’imaginer Jésus chez les Grecs, esclave athénien, il serait peut-être une façon d’Épicure ; esclave romain, un stoïque à la manière d’Epictète. Or, Tolstoï, pour évangéliste qu’il soit, ne peut s’empêcher d’avoir du grec et du romain, comme tous les modernes. Quoi qu’il fasse, il connaît l’immense ressort de l’État et de la Science. Quoi qu’il veuille, il ne ressuscite le Messie d’un peuple d’enfants violents et passionnés, que dans le monde moderne, qui est romain par la forme, et grec par la pensée. De là, que le ciel de Tolstoï paraît si loin. Il a beau le montrer dans la volonté affranchie et dédaigneuse de ce monde, il ne peut se dérober à ce monde même. Jésus ne se soucie pas des villes énormes, des continents en lutte, d’un bout de la terre relié à l’autre, des sciences et de l’art. Tolstoï est forcé de s’en occuper. Le principe d’« être comme des enfants » n’est doux que dans un monde enfantin. Là, même, il a du péril. Ce monde court le risque de se noyer dans un fleuve de lait. Mais si cet Éden peut se défendre de sa propre innocence, il ne le pourra contre la méchanceté d’autrui. Une horde de Turcs aura bientôt fait, ici, de tout mettre à mort ; là, de tout détruire ; ici et là, de violer les petites filles et les femmes : Ainsi, la race des méchants profitera de la bonté des bons, pour perpétuer sa propre méchanceté. Dans le monde selon Tolstoï, la perfection est l’exercice de la défaite et du martyre. Le Royaume des Cieux est ouvert sur les champs de la Mort. Sans doute. Il n’est que trop vrai.
Voilà en quoi Tolstoï est épicurien. Il règne la même ataraxie au fond de son Evangile qu’au fond de la Physique d’Épicure. Épicure disait : Sache tout, — et laisse faire. — Tolstoï dit : Souffre tout, — et laisse faire. L’intelligence, chez le Grec, et, chez le Russe, l’amour de Dieu, ou charité, suffisent à tout. Tolstoï unit le stoïque et l’épicurien dans le même abandon de soi très apostolique. Il est curieux de voir que le Christ y rencontre la victoire. Car c’est à peu près ainsi que le christianisme naissant a conquis la société antique.
Souvent, j’ai réfléchi sur la grande tristesse des livres de Tolstoï. Son accent n’était pas si désolé quand il ne savait où est la voie du salut, que depuis qu’il l’a trouvée. Il annonce le bonheur d’une voie sombre. Est-ce l’horreur du mal présent qui lui donne ce ton ? — À la vérité, il semble plutôt que ce bonheur soit désespéré. Jésus est le dernier mot de la sagesse humaine, — faute, peut-être, qu’il y en ait un autre. Ce monde d’enfants est le pis aller d’un monde d’hommes. L’innocence sans passion est la fin d’une créature, qui ne peut être passionnée sans être criminelle. L’enthousiasme de Tolstoï pour la vie n’est pas fort soutenu : il était beaucoup plus robuste dans le temps de ses doutes, quand il craignait tant la mort, quand il se torturait tant de vivre. Il consent à la vie, plus qu’il ne l’aime. C’est une philosophie de vieillard : le mot en vient, quoi qu’on en ait, aux lèvres, comme à l’esprit. Le Çakia-Mouni, aussi, a été roi, amant, père, avant de devenir un sage. La résignation à la mort est le grand prix de la vie. Accepter la mort, pour l’oublier. Oublier la vie, dans l’attente, sans pensée, de la mort. Les enfants font l’un et l’autre, et non par principe : en quoi ils ont un avantage incalculable. Cette ignorance est la caution du bonheur. Et, en effet, un enfant innocent, de bonne santé, de bon caractère, est à la fois un épicurien modèle, — et un parfait stoïcien : il accepte, il croit tout ; — et il jouit de tout selon ses facultés.
Il faut plus à l’homme. De là, le souci, la douleur, l’amertume. Il ne veut pas vivre seulement : il veut se sentir vivre, — et il apprend à se sentir mourir. Il ne lui suffit pas de jouir de l’heure : il veut jouir de toutes ; et il se compose un Moi, l’horloge où elles sonnent infiniment. Il veut même jouir de ses douleurs, par contraste. Non ; l’homme n’est pas un enfant. Celui qui y prétend le plus, souvent le peut le moins. Il ne peut ? Et s’il le pouvait, il ne le voudrait plus, peut-être. L’homme plein, comme il est tout volonté, tout acte et toute passion, veut jouir de sa vie, de ce qu’il a, de ce qu’il n’a pas, de ce qu’il craint. L’enfant n’est plus heureux, que parce qu’il est à peine. Qu’est un enfant ? Quasi rien. — Alors, je dis à Tolstoï : « Dans le fond, votre Évangile, à fin de nous rendre heureux, veut que nous soyons enfants, — pour être à peine. Mais il s’y cache une autre pensée, et la tristesse, selon mon goût, s’en étend à toute chose : Le vrai bonheur, pour rhomme, est de n’être point. L’idéal de la vie, — s’il n’est pas le non-être, difficile à concevoir, ou absurde, pour qui est — est, du moins, une mort paisible : un ruisseau qui coule, sans quitter un sable uni, — et s’y perd lentement. »
Une profonde horreur flotte parfois sur un calme rêve.
III
SI TOLSTOÏ EST CHRÉTIEN
Les Églises, nées du christianisme, ne sont pas toujours chrétiennes, car elles ont besoin de compter avec le monde, comme avec Dieu. Il n’est pas dans mon dessein de dire ce que je pense. Mais je veux faire entendre que l’opposition de toutes les Églises de la terre ne sauraient empêcher Tolstoï d’être un grand chrétien.
Les Églises chrétiennes peuvent finir, tant le siècle a d’exigences, par ne plus penser du tout à Jésus-Christ. Mais les grands chrétiens ne vivent que de l’amour de Jésus-Christ ou de l’Évangile, et ne respirent que lui. Nul signe ne les marque plus expressément ; et, pour divers soient-ils entre eux, il les fait de la même famille. Cet amour continuel du Christ, dans la personne ou la doctrine, il est en saint Bernard comme en saint François, dans le moine de l’Imitation si tendre, comme dans Pascal si terrible, et dans cet enfant fra Giovanni de Fiesole, comme dans Tolstoï, le plus mâle des esprits. Le grand amour de Dieu a rendu tous ces hommes également amateurs des tâches difficiles. Le royaume du ciel est le seul où il vaille la peine de vivre : et, comme il est le seul où la vie soit, en effet, possible, il n’est pas un trésor sous la main, encore qu’on ne le paye jamais trop cher, quelque prix qu’on y mette. Le lieu de la vie, qui ne donnerait volontiers tout son sang pour le joindre ? Considérez que vous ne mesurez votre peine qu’à vos misérables joies. Pensez un peu à ce que la vie veut dire. Et mesurez donc votre peine à la Mort, — voiLà le juste étalon de la vie.
Toujours, et partout, Tolstoï a regardé fixement la mort. Il l’a éprouvée dans tous les êtres, dans le prince et dans le mendiant, dans l’arbre, dans la bête. Nul homme ne connait rien, qui ne voie chaque objet, avec lui-même, obstinément dans la mort. Les esprits valent pour la vie à proportion de la vue qu’ils ont de la mort. Pénétrez les pensées de la mort, vous qui voulez vivre. Il n’est point de chrétien qui n’accole étroitement la mort à la vie, en sorte qu’il fiance et marie de bonne heure sa vie à sa mort, à fin d’en concevoir une vie nouvelle, qui dure, celle-là, qui soit certaine, et qui puisse un peu remplir le vide affreux de nos cœurs.
Malheur à l’idéal qui est sans difficulté : il n’a rien de solide pour l’âme. Tolstoï n’accepte point tous ceux qui vont à lui. Comme tous les fondateurs de religion, il veut des preuves ; il demande la plus rare, — une longue sincérité avec soi-même. Il faut craindre les fidèles d’un jour. Ceux qui sont aisés à gagner sont aisés à perdre. Que chacun se gagne, et s’obtienne de soi. Jésus-Christ demande beaucoup. C’est qu’il promet tout, et le donne : Voilà comme pense Tolstoï. Les mots, et même les élans non durables du cœur, ne sont point assez pour entrer dans le Royaume de Dieu. Et, il est dès ici, selon que l’a dit Jésus et que Tolstoï le montre. Le véritable amour est la fleur la plus rare de l’âme. Il la faut labourer longtemps, pour que la semence prenne et que la tige croisse. Comme François d’Assise se fiance à Pauvreté, sa Dame, Tolstoï s’est uni à Humanité, la triste délaissée de tous les hommes. Et il a recueilli cette veuve pleine de larmes, pour l’amour de Dieu.
S’il interprète bien ou mal l’Évangile, nul ne peut le dire : car l’Évangile recommande le premier de s’inspirer de l’esprit, et de ne point se dessécher sur la lettre. Que Tolstoï en ait la pensée, il suffit bien de cet amour infini qu’il y puise, pour s’en convaincre, et des conséquences qu’il en tire pour la vie. C’est la grâce de l’Évangile, que la perfection du sentiment y est toute simple. Les passions, par où l’homme se ruine, n’y sont pas méconnues ; mais il y semble aller de soi, selon l’Évangile, de les vaincre. Tolstoï donne une impression pareille ; il propose à l’homme une vie qui ne parait ardue que si, dit-il, l’on n’a pas ouvert les yeux sur l’horreur et l’absurdité de la vie du monde, son contraire. Comme dans l’Évangile, et dans le même esprit, Tolstoï montre au soir de chaque journée pure, le seuil ouvert de la Maison du Père ; et ce n’est point par parabole qu’il fait voir tous les hommes assis autour de la table fraternelle, en frères également aimés, s’ils se portent un égal amour, et pour qui le pain blanc et le sel sont préparés.
L’Évangile a les couleurs de l’Orient. Il est naturel que Tolstoï, oriental comme un poète de la Bible, ait plus que personne le ton et le goût de l’Évangile. Mais, au lieu de l’horizon étroit de la Palestine, il a l’imagination des espaces sans borne de la Russie. Si donc il interprète trop à sa guise le texte saint, il en a le sens par divination. Les grandes règles qu’il donne ont le caractère de perfection, à la fois voisine et inaccessible, qu’on remarque aux préceptes de Jésus-Christ. Leur sublime innocence est, en même temps, ce qu’il y a de plus naïf et de plus profond : chaque esprit y reconnaît la plénitude de ce que lui-même y porte, ou naïveté, ou profondeur. Et quiconque médite cet enseignement y découvre une vue insondable sur le cœur humain.
Une philosophie qui ne laisse pas de place au doute est une religion.
Et toute religion où s’exerce la critique cesse même d’être une philosophie.
La foi est grande en ce qu’elle oblige. Et par là, en dépit de tout, il y a une religion dans toute philosophie où le doute n’a plus de place. Elle aussi crée à l’homme des devoirs. Vous avez, sur toutes choses, besoin de vous connaître des devoirs. On ne vous a que trop entretenus de vos droits. Il n’en est de véritables, qu’à ceux qui les découvrent eux-mêmes, dans les nécessités de leur nature, et qui l’es obtiennent de leurs souffrances et de leurs combats. Voilà des droits que ceux qui les ont n’ont pas peu payé pour avoir. La vertu en est universelle, mais à titre d’exemple seulement ; elle ne suffit pas à donner une prérogative égale à ceux qui n’ont pas également souffert pour elle.
Tolstoï est muet sur les droits de l’homme. II ne lui propose que des devoirs, en échange du bonheur, qui est dans la pureté de conscience. Il offre donc une religion, car cette philosophie a la foi : elle en porte le caractère capital, qui est de fixer entre l’individu et l’univers, entre l’amour-propre et l’amour de Dieu, un rapport immuable, où le doute n’est plus permis et où, au regard de l’infiniment grand, le moi est un infiniment petit, une quantité négligeable, un pur rien.
Toutes les religions sont venues de l’Orient, parce que l’âme orientale immole entièrement le moi humain à l’infini : soit qu’elle l’en accable, soit qu’elle l’y absorbe ; qu’elle l’y mesure ou qu’elle l’y perde. La foi est à ce prix : c’est le point où toute philosophie, digne de ce nom, rencontre la religion ; quelles que soient leurs trajectoires, le terme des forces est unique, et elles y coïncident.
Le Bien est cet infini où Tolstoï ne conçoit même pas que le néant de l’homme résiste, car il ne prend quelque réalité que par rapport à lui. Tous les Russes, à cet égard, ont l’imagination orientale. L’individu leur semble un point, et sa prétention de compter par lui-même une vanité absurde. La politique slave est une expression concrète de cet esprit. La vie universelle hante leur pensée ; et leur foi n’élude jamais cette toute-présence. De là, leur grandeur morale et leur rôle dans le monde ; elle en doit être l’espoir contre le génie automate des peuples saxons : si tant est qu’il ne soit pas illusoire de nourrir une espérance quelconque pour le genre humain. Il ne vous est pas mauvais, en tout cas, de l’entretenir. Comme vous espérez pour vous, ne désespérez pas de lui : vous y avez votre intérêt.
Les Russes savent souffrir ; ils l’aiment, cette souffrance, et en pratiquent la communion, qui seule permet un amour si singulier. La mesure qu’ils font de toutes choses à l’étalon unique du bien, les engage à les toutes dédaigner. Ils pratiquent, de nature, cette vie éternelle, qui rend misérables les promesses de l’autre. De la sorte, ils ne daignent, ou ne savent pas vouloir.
IV
QUE LA DIFFICULTÉ FAIT l’IDÉAL MÊME
On conclut : la philosophie de Tolstoï est une doctrine de vieillard. Et Tolstoï, en effet, va contre toutes les passions. Il ne laisse à l’homme que celle du bien. Comme il semble en avoir eu, lui-même, beaucoup d’autres, on incline à lui accorder que sa vérité est sans doute vraie pour l’homme de soixante ans, mais ne peut l’être pour celui de trente.
Toutefois, ce n’est pas bien raisonner : ou, du moins, cette philosophie n’est pas d’un vieillard, pour les raisons qu’on dit. — Quand même l’homme et le chrétien ne pourraient mener une vie bonne qu’à condition de la dépassionner, Tolstoï ne dit point qu’on ne soit bon et juste, que purgé de toutes passions. Il ne donne pas davantage sa religion pour facile ; et il revendique justement la difficulté de son idéal comme une preuve de la bonté de cet idéal même. Un esprit est trop médiocre, en effet, qui s’attache à un idéal aisé, et sous la main. Qui le touche, le détruit : l’infirmité d’âme la plus irréparable est de croire à un idéal sans difficulté. Il vaut infiniment mieux n’y pas croire : en ces matières, le pire parti est de se plaire à s’abuser.
Tolstoï, jeune et passionné, aurait lutté pour sa religion, s’il n’avait dû la chercher ; il aurait combattu contre lui-même, au lieu de s’égarer en vains eftorts. Où est l’homme un peu noble, qui ne se livre d’incessants combats ? — Le malheur est de perdre sa force, on ne sait au profit de quoi. Avec une humilité admirable, cet orgueilleux Tolstoï confesse qu’il ne sera jamais un parfait chrétien, — et qu’il ne l’ignore pas. Mais quoi ? dit-il : faites ce que je dis ; ne faites pas ce que je fais. Pour moi-même, je fais tout ce que je peux ; faites tout ce que vous pouvez. Ne dites donc point de ma doctrine, qu’elle est bonne seulement à un vieillard ; dites seulement qu’il est plus aisé au vieillard de la bien suivre. Il est vrai, pourtant, qu’un vieillard sain, robuste et vertueux est un modèle d’homme admirable à imiter. Il n’y a même rien de meilleur que lui, quand sa bonté est forte, qu’elle ne sent pas la faiblesse d’esprit, et ne peut aucunement passer pour un effet de la décrépitude.
Si les jeunes gens ne peuvent être des sages dépassionnés, il leur est du moins possible de tendre à la sagesse ; encore mieux de l’aimer, et de n’être pas indulgents à leurs passions, surtout aux plus viles, comme il leur arrive souvent, — et comme il arrive toujours aux hommes dans la force de l’âge, quand ils s’y livrent. Toute vertu suppose une victoire. Il est bon de s’en proposer sur soi-même. Le vieillard l’obtient peut-être avec moins d’effort, et c’est sans doute parce qu’il a aussi moins de force. Mais en faut-il conclure que le jeune homme ne le puisse pas ?
Tolstoï aura toujours le droit de répondre que l’adultère n’est pas seulement un crime à l’homme vieux, mais au barbon et au jeune homme. Il n’est peut-être pas fatal à la nature humaine que les jeunes gens ne puissent vivre sans être adultères. Et, du reste, le remède qu’y voit Tolstoï confond cette sophistique. Pour ne pas être adultère, il montre au jeune homme que son devoir est de se marier. De la sorte, cette philosophie n’est pas faite à l’usage des vieilles gens. S’il est facile au vieillard de n’être pas adultère, il n’a qu’à ne pas se marier. Et si le jeune homme a des passions que le vieillard n’a point, il n’a qu’à prendre femme, où le vieillard ne doit plus prétendre.
L’Évangile, selon Tolstoï, n’est point une règle aisée ; mais il n’est pas légitime d’en faire une règle impossible. Au surplus, toute morale souffre la même difficulté : dans sa pureté parfaite, elle n’est pas possible, à moins d’un hardi défi à la nature, car l’homme est naturellement immoral ; et de même que la religion naturelle n’a rien à faire ni avec la religion, ni avec la nature, la morale de la nature se moque de la morale.
V
SUR LE SENS DE LA VIE ET LE SENS DE l’ART
Ils sont unis dans Tolstoï ; il ne peut pas en être autrement. Toute la philosophie de Tolstoï est sociale. C’est l’ennemi né de la métaphysique, le moins allemand des esprits. Le jeu des abstractions lui inspire un dégoût invincible. Il ne voit rien à considérer hors de l’homme. Il appelle vrai ce qui est humain, et concerne l’homme en société : car aucun philosophe n’a eu, plus que lui, la conviction que l’homme est l’animal social par excellence. De là, qu’il est injuste pour les anciens, lui qui raisonne à leur manière. Toutefois, à la cité des citoyens, il substitue la cité de Dieu. Il en croit l’heure proche ; et il en est partial contre Athènes. Le petit cercle qui enferme la cité antique lui semble d’un horizon si restreint qu il l’appelle barbare. C’est qu’il n’est pas sensible à la beauté en elle-même. On le voit bien, dans sa théorie de l’Art : il nie la beauté, et n’en fait qu’une relation sociale.
Quiconque n’est pas sensible à la beauté ne peut l’être au monde antique. Tolstoï veut qu’on lui définisse la beauté : il a raison de tourner en ridicule toutes les explications de mots qu’on en donne. Cependant, il se détend de définir la bonté : elle se sent de soi ; on la connaît en conscience ; elle passe toute formule. On en pourrait dire autant du beau. Mais Tolstoï mérite qu’on fasse un effort plus généreux. La beauté est la perfection vivante du moi. Elle est la révélation d’une vie sensuelle et parfaite, le plaisir suprême du moi en équilibre, qui jouit pleinement de l’harmonie entre sa volonté et ses moyens, sa pensée et ses sens, sa puissance et ses effets. L’Art est égoïste. Tolstoï ne le purifie pas du moi, ou bien il doit le sacrifier.
Sans opposer une esthétique à une esthétique, il faut reconnaître que Tolstoï juge de l’Art selon des règles morales, comme il juge de la Philosophie. C’est toujours selon le canon social ; c’est toujours selon la norme de l’utilité publique. Or, il arrive au véritable artiste de ne pas s’en soucier. Si on accorde à Tolstoï son principe, il faut tout lui accorder. On ne peut vivre humainement que si l’on tait du bien à tous les hommes ; on ne le peut que si l’on vit pour tous, et ne vit pas pour soi. — Tolstoï fonde là-dessus son édifice. Ainsi, le sens de la vie, pour lui, n’est pas une recherche de l’ordre spéculatif ni de celui des sciences. C’est une recherche éthique, et l’explication d’un ordre de faits capital pour l’homme en société. De la même manière, le sens de l’Art est un problème, en quelque sorte politique.
Il parle souvent de l’Art, comme un paysan chaste, égaré dans un musée. Il a de cette âme naïve, qui se prend d’abord au sens réel des images ; il se l’est donnée, peut-être : sa volonté accorde, sans cesse, la théorie avec la vie. Il trouve un principe juste, que le malheur des temps a seul pu rendre douteux : à savoir que l’œuvre d’art doit être intelligible. Ce qui n’est pas clair pour l’esprit n’est pas humain, et n’est ni de l’Art, ni de la beauté. L’Art a toujours été une révélation du cœur par la pensée, et de la pensée au cœur. L’émotion qu’il donne est universelle, — parce qu’il s’adresse à l’esprit par la voie des sentiments. Son privilège est de rendre clair à l’intelligence, ce qui est senti par la pitié, la haine et l’amour. Tout ce qu’on découvre, à la longue, dans le grand artiste, importe beaucoup moins que ce qui est impliqué, du premier coup, dans son œuvre, par l’émotion qu’elle donne. La pensée du poète peut prêter à une multitude de gloses et de commentaires. Ce qu’elle a d’essentiel est universel, est humain, — et, par là gagnant le cœur, s’établit dans tous les hommes : la condition unique est qu’ils ne soient pas trop inégaux à l’artiste, en sensibilité. Il est donc vrai qu’un art sans clarté, sans voie directe au cœur, n’est pas viable et n’a pas de beauté. Un art inhumain est absurde, comme un art qui nie la beauté. L’utilité suprême de l’âme ne peut être méconnue : elle veut s’élever au-dessus d’elle-même. L’Art est le moyen qui l’y aide, et par là une sorte de religion. L’œuvre d’Art est une prière. L’enfant voit tout son monde dans le « Notre Père », qu’il récite avec ferveur : dans son œuvre, le véritable artiste met tout le sien . La simplicité est ce qu’il y a de plus grand, car elle contient tout le reste. L’ambigu et le recherché n’ont qu’un faux mystère. Un poème, simple et clair comme une fleur, est incommensurable ; mais il semble ce qu’il y a de plus compréhensible, — et ce que l’émotion de chaque homme eût voulu trouver pour s’exprimer elle-même. Horatio, qui n’a pourtant pas l’âme d’Hamlet, devine l’infini de ses troubles : qu’est-ce davantage qu’un cimetière à traverser ? Quoi de plus vulgaire que de heurter du pied, dans la terre brune, fraîchement remuée, un ossement déjà verdi ? Que dirai-je plus, d’un poème admirable, qu’il est une fleur des champs, comme la rose dans le pré ? Ou, moins et mieux encore, une herbe verte dans la prairie ? — Qui ne sait combien cet humble brin d’herbe est infini et mystérieux en son être ? — Mais sa forme est ce que l’esprit le plus simple conçoit sans aucune peine et ce qu’il connaît le mieux. Ce qui n’est pas un objet de pensée n’est rien pour l’homme, et n’est rien, non plus, pour l’Art, car l’artiste est surtout l’ouvrier intellectuel de nos émotions. J’accorde que l’Art se réduise aux sensations seules : plus que jamais, il lui faut être direct et même grossier, car les objets des sens dépendent encore plus des lois universelles que ceux de la pensée.
VI
SUR L’ORGUEIL DE TOLSTOÏ
L’orgueil de Tolstoï est immense ; mais on en juge mal, communément. Beaucoup de personnes sont blessées des arrêts tranchants qu’il porte, depuis qu’il prononce sur le bien et le mal, sur la bonne et la mauvaise qualité des œuvres, par rapport à la morale chrétienne. Et peut être n’est-on si sensible à la sévérité de ses jugements que depuis le temps où il se mêle de prononcer sur les ouvrages de l’esprit. En France, comme à Florence ou à Athènes, la sévérité en cette matière ne se pardonne pas ; et presque tout le monde y voit de l’insolence, car chacun craint de passer par cette épreuve, s’imagine maltraité, et se révolte à l’avance de l’être.
Quand Tolstoï ne faisait pas le procès de l’Art, il ne paraissait pas d’un orgueil si intolérable. Ce n’est pas qu’il l’eût moins âpre et moins fort, mais il ne s’exerçait que touchant la vie, la vérité et le bien ; et ce sont de petits objets, au prix de l’amour-propre et de la vanité d’auteur. Il est vrai qu’un jugement si dur, et si à l’aise dans le mépris, étonne venant d’une âme chrétienne et d’un esprit où la charité doit avoir le pas même sur l’exacte justice. Mais il n’est pas loisible, même aux plus grands apôtres, d’être chrétiens parfaits, comme les solitaires. Ils ont l’épée de saint Paul ; et même quand ils en détestent l’usage, — bien plus, quand le doute les prend de son utilité, — c’est sur le glaive qu’ils s’appuient, comme on voit, selon la profonde pensée de Raphaël, saint Paul méditer, la main sur son arme, aux mérites singuliers de sainte Cécile, à la victoire de la musique et de la seule douceur. Les apôtres sont nés pour combattre ; et la lutte porte en soi sa dureté.
Il est douteux qu’il y ait jamais eu une grande âme sans orgueil, — ou une petite sans vanité. Toute la différence de l’orgueil des unes à l’orgueil des autres est de savoir où on l’a placé. Dans tous ses livres, Tolstoï est orgueilleux : il accuse son amour-propre d’enfant, comme son entêtement d’homme fait, qui s’opiniâtre dans ses vues, et les préfère à celles d’autrui. Toutefois, plus l’orgueil de Tolstoï est sûr de lui et se déclare sans égards, moins Tolstoï lui est sévère. Et il y aurait bien lieu de s’en étonner, comme d’une singularité morale tout à fait contraire à l’idée qu’on se fait d’un saint, d’un chrétien, ou seulement d’un sage, si ce trait n’était précisément le plus propre à marquer le véritable caractère de cet orgueil.
Au début de sa vie, Tolstoï rougit de son amour-propre. Plus tard, il en souffre. Il est si loin de la vanité, qu’il ne craint pas, souvent, d’en avoir l’apparence. En quoi il fait bien : il n’y a qu’un petit homme, pour se tromper si grossièrement, et trouver de sa vanité dans ces grands orgueilleux. Jamais on ne surprend Lévine, ni Bésoukhow, satisfaits d’avoir raison. Ils sont déterminés critiques, et ruinent les opinions des autres, par besoin d’y voir clair et d’être sincères avec eux-mêmes. Mais ils ne se savent point gré de le faire. Ils en souffrent plutôt ; et même, quand ils semblent intraitables aux gens de leur société, tiers de penser à l’encontre de tout le monde, ils n’en sentent en secret aucun contentement. On les tient orgueilleux ; et, se défendant de l’être, ils souffrent surtout de ne l’être pas.
Est-ce donc que Tolstoï aime tant l’orgueil ? — En rien : il en sait la malice ; il en a éprouvé les douloureuses chances, et ces maux qui vont jusques aux fureurs convulsives ; son esprit enfin, avant d’en être purifié par l’Évangile, ne lui laisse ignorer aucun inconvénient de cette passion. Mais il voudrait la sentir en lui, pour être sûr qu’il en sent la cause. II voudrait avoir l’orgueil qui, en un homme de sa sorte, n’est qu’un effet de la certitude d’avoir raison. Pour tout dire, l’orgueil de Tolstoï se réduit à la conscience nette de la vérité. Cet orgueil étrange est un témoin de la foi.
Voilà pourquoi Tolstoï se reprochait ce qui y ressemble, et combattait l’amour-propre en lui ; — et voilà pourquoi il lui donne carrière dans toute sa force, et ne semble pas se soucier d’en modérer seulement l’éclat. Il n’est pas facile aux hommes d’aujourd’hui d’entendre un orgueil, d’autant plus violent, que l’orgueilleux croit y mettre moins de lui-même. La foi conseille l’humilité, et même la commande. Mais cette foi est celle qui procède de la Grâce, et d’un don bénévole, de l’octroi de Dieu. Or, il n’y a ni grâce, ni don accordé à la prière dans la foi de Tolstoï. Je l’ai déjà dit : sa foi est toute rationnelle. Il a la vérité ; il l’a trouvée ; et la prouve aux hommes, dont le cœur est assez pur pour ne pas corrompre le présent limpide qui leur est fait du vrai par la raison.
C’est la raison qui persuade la raison, et, l’armant de la vérité, la convainc de gagner le cœur. Il suit de là que l’orgueil est la force que la raison met dans ses preuves, et dont elle poursuit le contraire de la vérité, soit par le sarcasme, soit par le dédain. Il n’y a, pour ainsi idre, dans cet orgueil, rien de l’homme ni du caractère : il est tout de l’esprit.
La vérité est, de soi, aussi violemment orgueilleuse vis-à-vis de l’erreur, qu’elle est humble avec elle-même — car il n’importe rien autre à la vérité que d’être vraie. Considérez que tout l’orgueil est dans ce que nous mettons de notre personne en nos actes et nos paroles. Mais, pour orgueilleux qu’ils fussent dans le fond de leur cœur, Descartes ni Spinosa n’ont point d’orgueil dans leurs théorèmes. On ne peut reprendre Spinoza sur son orgueil qu’en n’écoutant point ce qu’il dit, et qu’en donnant toute son attention à sa manière de le dire.
Tolstoï est un homme de ce temps-là, — et je veux dire d’il y a vingt siècles. Comme Descartes, il me fait l’effet d’un ancien. Leur orgueil, comme tout le reste, tient au pouvoir capital qu’ils accordent à la raison. Dès lors qu’ils croient tenir la vérité, ils en accablent le mensonge et l’erreur : et c’est bien fait. La vérité sera toujours plus dure et plus résolue, plus terme en son propos contre l’erreur, que le bien et la vertu contre le vice et le crime même. Rien n’est terrible pour l’erreur, comme la vérité démontrée : elle ne la condamne pas seulement, — elle l’anéantit. De la sorte, Tolstoï, assuré d’être vrai, saisit les erreurs et les réduit cà néant. Il ne distingue point entre celles du jugement et celles de la conduite.
Je ne controverse point contre Tolstoï ; je le montre. Si son Évangile est le vrai, il ruine justement les mœurs et les œuvres, qui y sont opposés en principe. Il ne lui faut qu’un mot de paysan, pour priver Wagner de ses droits sur le cœur des hommes, et les convaincre de fuir les charmes de cette sirène. Quand Tolstoï dit d’une œuvre « qu’il ne la comprend pas », — il la condamne à disparaître ; il ne lui en faut pas d’autre motif. Et, sans doute, si on prend cet arrêt de lui, comme on ferait d’un autre homme, il semble plein d’un orgueil intolérable : pourquoi l’intelligence de cet homme se donne-t-elle pour la mesure de toute intelligence ? — Un tel excès du sentiment propre serait sans excuse. Quoique, du reste, en l’occasion, un Tolstoï fût fondé à prendre en parfait mépris tous les auteurs, moins deux, et les œuvres qu’il jette au néant[1]. Mais il en a une raison, qui le dispense de toute autre. Il mesure les objets humains sur le rapport qu’ils ont à une quantité divine, — qui est la vérité. Et l’instrument de la mesure, cette intelligence, qui ravale à néant ce qui lui échappe, n’est pas, pour Tolstoï, l’esprit de Tolstoï même : mais, seulement, la faculté mise en tout homme d’atteindre cette divine réalité, et de la reconnaître.
VII
SUR LES PORTRAITS DE TOLSTOÏ
Tolstoï est le centre de chacun de ses grands ouvrages. Il en fait l’unité, que l’esprit léger ne leur voit pas d’abord. Ces tableaux immenses de toute une époque, de toute une société, sont le cadre d’un drame particulier, où le sort d’une conscience se joue. Il y va toujours de la vie, pour ces héros ; et, comme pour Tolstoï, leur vie n’a point de sens, que dans son étroite union avec la vie universelle.
Dans Guerre et Paix, il s’agit, avant tout, de savoir quel effet les catastrophes de la patrie ont sur Pierre Bésoukhow, et le rapport de cette vie à celle de tout le peuple. Bésoukhow est le raccourci de toute sa race, I’homme de grande famille où, grâce au mélange du sang et au hasard d’une naissance irrégulière, la nature du moujik prend conscience d’elle-même ; il arrive que cette histoire d’un seul, loin d’être un épisode du poème, en est le sujet véritable. Les immenses proportions d’une épopée nationale cachent ce dessein avec un art infini. La colère d’Achille se mêle, à peu près de la même manière, à la guerre des Grecs contre Troie, qui est l’Iliade.
Anna Kharénine est l’occasion, pour Tolstoï, d’éprouver toutes les idées morales et les principes où notre société repose. Il les prend dans leur pureté, et les suit jusque dans le feu de leur propre révolte, où ils se désagrègent et se dissolvent. Les malheurs d’un couple passionné sont l’épisode le plus frappant de cette histoire. Mais les doutes et les expériences de Lévine en forment le fond. Le témoin de la tragédie, qui en fait constamment l’analyse, est le héros du drame : il est au cœur de ce monde condamné, dont les formes de mort sont plusieurs fois sur le point de l’emprisonner lui-même ; mais il garde la vie, et il la doit, peut-être, à la recherche perpétuelle des conditions où elle est possible. Lt douloureuse amante, qui avait en elle toutes les forces et toutes les séductions de la vie, en est dépouillée, peu à peu, par les crimes sans nombre d’une société si absurde, qu’elle fait le mal et le subit également, presque sans être criminelle : « Je me suis réservé la Vengeance », dit le Seigneur. C’est l’inscription mise par Tolstoï au frontispice de l’œuvre. Tout ne finit point avec la mort d’Anna, — ni sur le désespoir de Wronsky. Ils étaient condamnés avant de naître, étant sans remords de cette société, dont la vie est une mort continue. La Guerre et la Paix s’achèvent sur une promesse de vie, mélancolique et admirable : on voit poindre un jour nouveau, en tout pareil aux jours écoulés, dont l’importance semblait unique, les péripéties sans secondes, les événements irréparables ; — et pourtant, Bésoukhow ayant fondé une famille, les fils ayant pris la place des pères, la vie, semblable à elle-même, recommence. Dans Anna Kharénine, les maux de la passion tuent leurs victimes ; et les hommes, qui y ont échappé, pour une cause ou l’autre, continuent de vivre : Lévine, qui a été le confident de tous, l’est enfin de la vie ; et la scène ne se ferme que sur cette révélation capitale : il fallait au milieu de ce monde, plein de contradictions, d’absurdité, de maux, de fautes et d’erreurs, — que l’univers dît son secret à une conscience d’homme.
La docilité exemplaire du peuple russe envers le destin a été l’instrument de sa profondeur psychologique. Que la conséquence n’en paraisse point singulière : le sens de la fatalité est à la base d’une conscience profonde. Le peuple russe, habitué à souffrir, dédaigne l’accident. Il en arrive aisément à ne pas tenir grand compte de ce qui le touche. Nulle part, on ne se donne moins la mort, — et nulle part, cependant, on ne meurt mieux. Je veux bien qu’il tombe par là en torpeur, et qu’un nombre immense de ces pauvres diables ait passé des siècles dans un abrutissement stupide. Il suffit que les yeux de la pensée s’ouvrent sur ce monde intérieur où, pendant son sommeil, elle a seulement vécu, — pour qu’ils y voient plus loin que n’ont accoutumé les autres. Tolstoï est le Russe qui a vu ce fond caché. On suit en lui l’histoire entière du génie moscovite. Peu de poètes ont jamais été d’une telle importance pour leur nation.
Tolstoï est né d’une famille noble, des premières du pays, mêlée en tout temps à son histoire. Le grand seigneur, aujourd’hui même, en Russie, est encore un produit de l’artifice. À ne le prendre qu’en ce qu’il montre de lui, nulle part un tel abîme ne sépare le peuple de l’homme de la première classe. Il est ce qu’on veut qu’il soit. Pendant un siècle, on l’a connu sous la forme du marquis français. Il a passé de ce style à celui de l’Angleterre. Il a porté d’autres habits encore, et s’est toujours déguisé à s’y méprendre. Mais le masque, pour habilement fixé qu’il soit, l’est sur une chair, des os, et le sang russes. Toutes les modes de l’Occident n’étouffent pas cet Oriental. D’abord, il garde sa force, qu’il aurait dû perdre, ayant imité les vices de ses maîtres plus facilement que leurs vertus. Toutes sortes de corruptions n’ont pas gâté le fond de cet homme, qui excelle à se corrompre : s’il gagne la gangrène de l’Europe, le plus souvent elle ne lui entame pas le squelette.
On prétend qu’en grattant ce raffiné, on met à nu le barbare : c’est l’être neuf et sain qu’on veut dire. La même force, qu’il porte dans le vice et l’hypocrisie, nous est garante de celle qu’il a pour le bien et la vérité. Sans aucun doute, ceux de ces Russes, qui cèdent à une corruption si multiple, y atteignent un degré inconnu de méchanceté. Ils y mettent une réalité sensuelle, un scepticisme froid, une cruauté décidée et glaciale, où les Anglais eux-mêmes ne parviennent point ; car, chez ceux-ci, la raison vacille de bonne heure, et la demi-folie est habituelle au demi-équilibre. La force sensée que le Russe corrompu peut exercer dans le mal est un prodige. Userait trop long de montrer d’où ce monstre tire sa vigueur, et de quelle moelle il est nourri.
Au contraire, le Russe qui résiste, ne perd pas son vernis de politesse et rentre en ses vertus de barbare. Le sol cultivé porte une plante plus vigoureuse. Le tempérament moral reprend le dessus. D’un ancien capitaine, qui eût mené une province à la tartare, il naît quelquefois un philanthrope mystique, ou un de ces rêveurs, incapables d’agir, mais qui, même ivrognes, mettent tant d’humanité dans leurs songeries. Quand la crise morale, par où passent ces hommes, laisse leurs muscles intacts pour l’action, ils y font preuve d’une intelligence et d’une valeur étonnantes. On a dit de cette haute classe, où la Russie recrute presque tous ses hommes éminents et ses hommes d’Etat, qu’elle forme un des groupes humains le mieux doués, le mieux armés pour la vie, et le plus hardis en entreprises, qui se soient produits sur la scène du monde. Tolstoï aurait compté dans leur nombre, s’il avait voulu. Comme ils sont à la tête de la société qu’il voue à la destruction, Tolstoï ne se lasse pas de les combattre : son opiniâtreté et ses sarcasmes sont la mesure de ce qu’ils valent.
Tolstoï les connaît bien, dans ce qu’ils ont de pis et d’excellent. Son frère a été ministre. Sa famille a toujours occupé les plus grands emplois. Lui-même a été tous ces hommes, les uns après les autres, avant de rompre avec cet ordre social. Il en a longtemps suivi les modèles, comme son temps les lui offrait. Pourtant, la passion qu’il y portait, et le mépris secret dont il ne cessait de se poursuivre, l’en distinguèrent dès lors. Il raconte comment, à vingt ans, il plaçait l’idéal de la vie humaine à être « un homme comme il faut », de la tête aux pieds ; et, quelques tortures que lui aient coûtées ses prétentions à l’élégance, il avoue n’avoir jamais atteint à la perfection de niaiser. Il ne s’y élevait pas au-dessus du médiocre. Il en désespérait. D’amour-propre vain et timide, épris de rêves romantiques, jeune officier à la Byron, comme Pouschkine et Lermontow, il n’était pas loin, à cette époque, de mettre très haut une origine noble, de grands biens, une mine galante, les croix, les cordons, la clef dans le dos et la gloire des cours. Pierre Bésoukhow, dans la Guerre et la Paix, sacrifie encore, jusqu’à la trentième année, à la vanité mondaine. Mais il se guérit bientôt de l’ambition, et de jouer un rôle : il sent à merveille qu’il y a, en lui, un élément — force ou faiblesse — qui s’opposera toujours à son succès dans le monde. Il ne peut pas plus être un employé correct de l’État qu’il n’a pu se pousser à la dignité « d’homme comme il faut ». Bésoukhow prend part à la guerre de 1812, et la voit de ces yeux, qui ont suivi le siège de Sébastopol, avec une attention si profonde. Expérience décisive : la mort, le sang versé, les blessures, les ambulances, la pourriture d’hôpital ont effacé, dans cet esprit en quête de vérité, toute créance à l’héroïsme. En ce temps-là, Tolstof avait 30 ans ; et il quitta l’armée. — Il peint, dans Bésoukhow, son personnage au milieu de ces scènes terribles, comment et sous quelle forme il en est sorti. Bésoukhow s’éveille à la conscience, parmi les maux de la guerre et les souffrances du peuple. Il cherche sa voie morale ; et, presque à son insu, il ne rentre en lui-même, et dans l’homme, qu’en dépouillant le grand seigneur. L’homme d’emprunt, comme on le fabrique à Pétersbourg, laisse paraître le Moscovite. Ce bon géant vainement a forcé sa nature ; il se redresse : on a eu beau courber l’arbre, on ne l’a pas mutilé, et il tient à ses racines. Bésoukhow paraît aussitôt ce que le monde ne croyait pas qu’il fût : d’intelligence vaste ; d’une force et d’une pureté de cœur incorruptibles ; d’une candide bonté, qui ne craint pas de verser dans la faiblesse. Il ne lui manque que la volonté ; et une doctrine ferme sur la vie : car, il ne saurait vouloir, à moins de tenir le vrai. Tolstoï, avec cette perfection d’art que la réflexion seule aperçoit, a fait de Bésoukhow un homme timide et gauche, taillé en colosse. Il est propre à tout ; mais il semble emprisonné dans sa lourde et puissante nature. Il est faible en apparence, obéissant, presque endormi : mais vienne un grand devoir, vienne la nécessité d’agir, — et l’on sent quel ressort meut cette masse. Il se fera voir, alors, puissant en dévouement, en amour, en exquise délicatesse ; et il a la vertu suprême des cœurs sans défaut : un intime et irrésistible courage. En lui, c’est vraiment la Russie qui prend conscience de soi. Il rejette pour elles les croyances étrangères, après les avoir tentées toutes : essai loyal jusqu’à la naïveté et la maladresse, mais qui ne pouvait suffire.
Au jour du danger, on ne doit se guider que sur soi, — et non sur l’exemple des autres, fût-ce des plus excellents. Comme Bésoukhow, la Russie, au moment de la catastrophe, après avoir tant attendu des généraux et des diplomates, de Stein et de Barclay, des ministres et du tsar même, tourne enfin les yeux sur le moujik, et le paysan russe fait son salut. À combien d’erreurs, de crimes involontaires, de coutumes perverses, Bésoukhow et la Russie, rougissant de leurs propres forces, la vue courte, les membres embarrassés, ne s’étaient-ils pas abandonnés dans leur mollesse ? — Mais quand Bésoukhow, dans le malheur de la patrie, a tout perdu, et l’intérêt même de vivre, — le moujik, qui a tiré la Russie de la mort, lui rend le goût de la vie. Bésoukhow se connaît un frère dans l’humble camarade, dont ni les souffrances, ni la mort ne désarme la foi. Tolstoï a compris que le peuple russe est né en ce jour. Dès lors, Bésoukhow décide de vivre à la mode de son peuple, en paix, presque en communauté, s’il se peut, avec tous les hommes de sa race, en formant un foyer, où tous ont, plus qu’ailleurs, quelque chance d’être admis, — et le plus près possible de la terre.
Lévine n’est autre que Bésoukhow retiré dans ses quartiers, à la campagne. La vraie Russie est aux champs. Les villes y sont, presque partout, de vastes villages. Lévine comprend assez tôt qu’il n’est pas plus possible à l’homme policé de faire un paysan, qu’au paysan de devenir un seigneur. Le paysan, se préfère au seigneur, et se moque du seigneur qui ne se préfère pas au paysan. Quel éloignement de l’apparence du moujik, à être un moujik soi-même : Et, du reste, à quoi sert de l’être ? — Lévine ne touche pas, du premier coup, à ce désenchantement. Plus tard, une foule d’expériences l’ont instruit : il ne doute plus qu’il ne continue à se nuire, s’il sert ses paysans, — et qu’il ne nuise à ses paysans, s’il résout de se servir. Il a vu la peste sociale qui règne en Occident et dans les villes. Il ne voit pas avec moins de clarté quels maux rongent la Russie. Les remèdes qu’on y propose lui paraissent dangereux et ridicules. Il ne se paye pas de panslavisme ou de philanthropie. La famille, qu’il crée à son tour au foyer même où il est né, ne le satisfait pas davantage. La vanité universelle de tous les efforts, de tous les partis, de toutes les conditions possibles de la vie, l’obsède au point de l’empêcher de vivre. Il ne lui reste qu’une vérité certaine : c’est que le moujik, ce grossier paysan, connaît seul le sens de la vie ; et que, parfois, ce misérable paysan, même dans la pauvreté, même dans la vie, même dans la mort, trouve le bonheur.
Tolstoï avait appris qu’il ne tallait point compter qu’il fit jamais un moujik véritable de lui-même. Il savait, en outre, que ce paysan n’est point du tout l’homme parfait. Il ne doutait plus qu’aucun homme, de quelque classe qu’il fût, ne gagnât rien à être d’une autre classe qu’il n’est, — en l’admettant possible. Il en conclut qu’il fallait chercher une condition nouvelle, propre aux uns et aux autres. Or, ayant connu que le bien seul est commun et nécessaire à tous, — comme étant la condition du bonheur et sa fin même, — il trouva que si l’homme veut répondre à ces deux nécessités de son être, s’il veut être à la fois heureux et juste, il ne lui reste que l’issue unique de mener une vie chrétienne.
⁂
Les nombreux portraits qu’on a de Tolstoï reflètent exactement les époques de sa vie morale[2]. On en a de l’âge de 30 ans à celui de 70. Ils semblent n’être tous que des ébauches, souvent malheureuses, à la grande image du vieillard.
Il n’est pas de haute taille ; pour un Russe, il est plutôt petit. Il a les épaules puissantes et larges, le dos vaste, le col épais et robuste. Il respire la force ; sa poitrine est un bloc solide et musculeux. Sa vigueur, même enfant, était déjà très grande. Vieillard, il a les apparences de la pleine maturité. Il est d’une verdeur qui étonne, droit, ferme sur sa base, libre de ses mouvements, les bras capables des travaux les plus pénibles, les jambes bonnes à des marches prolongées. Son squelette est osseux, et dans sa personne les muscles dominent. Il a les mains plus belles qu’on n’attendrait d’un homme qui en a fait ses ouvrières ; larges du reste, et dures. À l’âge où il est parvenu, sa chevelure et sa barbe sont blanches. Il avait le poil noir, très épais, rude et abondant. Sa figure, si belle aujourd’hui, ne l’était pas, à beaucoup près, autant dans sa jeunesse. Il dit lui-même qu’il a toujours été laid, et qu’il en a plus souffert que de rien autre. Son teint est brun, et hàlé par une vie entière passée au soleil et au plein air. Il a le front osseux, rond, médiocre en hauteur, assez large, avec ces tempes sèches et évidées, qu’on voit à beaucoup de visages, en Orient. Les sourcils, naturellement très touffus, sont encore plus épais, depuis que, jeune homme, il lui prit fantaisie de les raser, pour les faire croître, et se donner un air énergique. Le nez est fort, un peu gros du bout, et largement étalé entre deux plis profonds qui vont jusqu’à la bouche. Les oreilles sont fort grosses, quoique d’un assez beau dessin. La bouche est grande, les lèvres fortes, d’un contour simple, mais d’une expression admirable : on ne peut s’imaginer une forme plus éloquente ; et, même serrées, elles semblent pleines de paroles. Trois grandes rides courent sur le front, d’une tempe à l’autre, dans le sens des sourcils. C’est eux, c’est leur arche touffue et sombre, qui enchâsse ces yeux, d’une beauté singulière, où toute la vie du visage est contenue, et dont le sentiment de la bouche n’est que le reflet. Il les a assez petits, oblongs, reculés dans l’orbite, de couleur grise ; le regard profond et clair, parfois aigu, comme si le feu vif qu’il recèle venait à percer le voile léger dont il est couvert. Cette vapeur sur un foyer brûlant a dû faire le grand charme de ces yeux, qui firent tout celui de la personne. Comme beaucoup de contemplateurs attentifs, Tolstoï a la vue basse. Il n’avait rien pour plaire, et il n’a pas plu aux femmes : elles n’ont pas trouvé en lui l’espèce de cavalier à la française, ou d’Anglais homme de salon, fin, correct, précis et flatteur à porter au bras, comme un objet de la bonne fabrique, — où vont toutes leurs préférences, quand elles ne les réservent point à quelque animal piaffant et lustré, qui tient le milieu entre le chanteur de bravoure et le coursier qu’il monte dans sa romance. — La conscience de sa laideur a longtemps tourmenté Tolstoï : comment ne pas savoir gré à un tel homme d’un aveu où se cache une profonde vérité, en général inaperçue, ou qu’on raille puérilement d’être puérile ? Il est bien vrai, comme dit Tolstoï, que rien n’importe peut-être plus à la vie entière que le sentiment qu’on a de sa laideur physique, ou de sa beauté. Pour lui, il fut un temps où il eût tout donné, en retour d’un air de tête séducteur, d’une joue longue, du teint et du poil soyeux d’un pair d’Angleterre, — et de cette tournure élégante, qui semble un aimant pour les désirs féminins, et qui forme un champ magnétique à l’attention, et — avouez-le — à l’envie des hommes.
Si Tolstoï avait besoin qu’on le justifiât d’avoir passé des lettres à l’Évangile, on aurait assez fait de comparer les portraits qu’on a de lui avant sa conversion à ceux qui l’ont suivie. L’or pur de cette nature s’est dégagé de tout alliage. Quel témoin incorruptible de l’âme, parfois, c’est le visage d’un homme ! La voici, désormais, cette figure inoubliable. Dans sa blouse de paysan, serrée d’une courroie à la ceinture, soit que Tolstoï, coiffé d’une casquette, fauche la moisson, — soit qu’il fasse, tête nue, le geste de prendre la parole, — son attitude et ses traits respirent une grandeur et une simplicité bibliques.
Sa longue barbe, mêlée aux moustaches, ne laisse plus voir de la bouche que des lèvres où la bonté et la conviction se fortitient l’une de l’autre ; ces cheveux entourant les oreilles ; ces sourcils broussailleux, d’où le regard concentré s’élance ; cette pensée ardente et fixe, où veille on ne sait quoi d’inquiétant : c’est la tète d’un prophète hébreux, une indomptable ténacité, une foi qui ne craint rien, l’orgueil de la vérité, le reflet d’une âme illuminée, et qui a vu Dieu dans le buisson.
Il a beaucoup, à sa manière, d’une des figures de Michel-Ange, au plafond de la Sixtine. Et, tel de ses portraits, au regard fixe, presque terrible, quoique sans modèle dans la société des Titans sacrés, conçus par le grand artiste, ne serait pas hors de place entre Ézéchiel et Isaïe.
VIII
D’UNE OBJECTION CAPITALE AUX THÉORIES DE TOLSTOÏ
Je ne trouve point convenable qu’on se serve contre Toktoï des arguments ordinaires, et propres à une discussion en forme. Il est manifeste que sa doctrine repose, comme une religion, sur un acte de foi ; peu importe si, d’aventure, il le fait à la raison : la grâce n’y a pas moins de part qu’en tout abandon de l’amour-propre à l’amour de Dieu.
L’objection la plus forte qu’il y ait aux théories de Tolstoï, — c’est Tolstoï lui-même. Non pas sa vie, ses défaillances, — qu’il avoue d’un cœur si admirable ; ni ce passé, magnifique en œuvres de toute sorte, qu’il désavoue, pour nous le rendre plus cher ; et, glorieux vieillard, dont il accroît la gloire, en ne s’y bornant pas. Cette difficulté capitale vient de son caractère. En un mot, sans ce que Tolstoï condamne, il n’eût jamais trouvé en lui la force ni la grandeur d’âme nécessaires pour le condamner. S’il n’avait été un des plus passionnés entre les hommes, il n’aurait pas eu de quoi combattre les passions comme il le fait. S’il n’était point né riche en force, voire en violence, il n’eût pas été ce soldat héroïque du vrai qu’on le voit être. Les saints qui répandent la sainteté sont ces mêmes violents que leur sainteté réprouve. Et ceux qui les suivent sont ces tièdes et ces indifférents, qu’ils détestent quand ils n’en sont pas suivis. La même force, qui s’égare et fait le mal, anime le juste, le pousse dans la voie droite, et lui fait faire le bien.
Pour ne parler que de la guerre, si Tolstoï n’avait pas été capable de s’y livrer, comme à la chasse, avec toute l’ardeur de l’homme prêt à sacrifier sa vie, il ne l’eût pas été d’en avoir cette horreur profonde, où il montre un égal courage. Le lieutenant de Sébastopol est la caution du vieillard pacifique, avide de souffrir persécution pour la justice. C’est le jeune homme, délicat sur l’honneur et l’amour-propre, jusqu’à la sottise, qui peut seul humilier l’orgueil, comme Tolstoï a fini par faire : l’ardeur qu’il mit à ressentir les offenses, il l’a mise depuis à les pardonner. Il faut avoir voulu tuer un homme, sur un regard insolent, pour prendre sur soi de tendre l’autre joue au second soufflet.
Quiconque raisonne de la violence, sans réfléchir à la nature de l’homme, n’a pas de peine à la noircir, et à la prouver absurde. Il est absurde, en effet, de faire le mal, surtout sous prétexte du bien : ce qui est le cas de la guerre et des révolutions. Mais il n’est absurde que s’il est possible de faire autrement. La nature humaine, seule, est juge de ses moyens. Or, le fait est que la violence est un signe de la force. Les actes de l’homme ne se calculent pas à la machine arithmétique. Ce ne sont point des raisons multipliées les unes par les autres qui déterminent les actions. L’homme n’est pas uniquement raisonnable. Il serait, plutôt, uniquement le contraire, parfois. Souvent, des droits qui se multiplient ont pour résultat de terribles injustices : voilà des opérations que la mathématique ne connaît pas.
Je vois bien que la faiblesse, la corruption, la lâcheté, et les états les plus infirmes de l’être humain, prennent, à l’occasion, les dehors de la violence. Mais quoi ? — c’est un masque qu’ils se mettent, — et celui précisément de la force. Parfaite et bien réglée, la force suit un cours, d’où la violence semble exclue : un fleuve, cependant, n’est pas moins un fleuve et la vie d’une contrée, pour rompre ses digues. Il est fâcheux qu’il les arrache ; il l’est plus encore qu’on ne les lui ait pas mises. Les le point capital est que ce fleuve coule, et qu’il existe. Personne, même de ses victimes, ne préférerait qu’il ne fût pas. On ne peut persuader aux Siciliens de Catane de ne point planter leurs vignes, cent fois détruites par la lave, sur les flancs enchantés de l’Etna : la beauté de la terre, sa fécondité, et la qualité du vin qu’elle nourrit de son feu, font pardonner au volcan, et oublier ses fureurs, quand il est dans son humeur de précipiter le ravage et la misère.
Le mal est qu’on ruine la force, le plus souvent, en faisant procès à la violence. Les forts, je le sais, y mettent toute la leur, — et c’est une de leurs marques les plus certaines. On dirait qu’ils se défient de toute force, en dehors de celle qu’ils ont, — ou qu’ils la voulussent toute pour eux.
Le préjugé contre la guerre vient de là. Elle révolte une âme pensante, qui éprouve largement les souffrances humaines. Mais l’erreur est de chercher si la guerre est juste, — ou non si elle est nécessaire. Il est trop aisé de répondre à des questions où l’on fait argument de la proposition même. Une certaine manière de poser les problèmes, les résout. Quant au juste, il ne le sera jamais, de s’entre-tuer par myriades, aveuglément, et de voler le bien d’autrui, en laissant derrière soi des amas de cadavres. Il n’est pas évident, non plus, qu’il y ait avantage, pour les hommes, de se tuer par monceaux, de promener la mort et l’incendie dans les champs et par les villes. Aussi, n’est-ce pas la question. Mais elle est de savoir si la guerre est dans la nature de l’homme à l’égal de l’envie, de la haine ou de l’avarice ; et si, (quand il la fait, il obéit à son instinct, comme quand il fait son pain, ou l’amour, — ou comme lorsqu’il se lance sur la mer, voyage par le monde, et accomplit ses autres travaux.
Tolstoï ne pourra, lui-même, nier que les peuples font la guerre en raison de leur force. Quand ils ne la font plus, ils la subissent. Ils cèdent, — et Tolstoï le trouve bon. Il oublie de peser la rançon de cette bonté précaire, à quel prix elle s’achète. Rome conquérante est terrible ; mais Rome conquise est pourrie. Dans cette Rome corrompue, voici que l’on s’assassine beaucoup plus que dans la Rome sanguinaire. Supposé que la corruption et la paix de parti pris n’aillent point ensemble, — l’amour invétéré du repos et la faiblesse ne se séparent point. Et, selon mon goût, qui dit faiblesse dit impureté : elle n’est pas déclarée, mais elle est près de l’être. Rien n’est pur que ce qui résiste, et ne craint pas la lutte. Rien n’est mieux armé pour la vie, que ce qui ne redoute pas de la perdre, et brave la mort. Pour un saint qui s’humilie, il y a un nombre infini d’âmes lâches et serviles, qui s’endorment dans l’humiliation comme dans un lit de plumes. Tirez la couverture, et le drap de la mort sur ces corps inertes.
S’il fallait un exemple, on l’aurait dans l’Espagne. Ce pays n’est plus en état de faire la guerre ; et Tolstoï l’en louera. Mais il l’est encore moins de rien faire, — et non pas même des enfants. Ce peuple s’est cloîtré. Sa paresse est son cloître. Et déjà, bien qu’elle se cache, s’avance la mort, qui est le prieur.
La guerre est bien une violence. Mais la violence est le signe de la force, et la nature humaine le veut ainsi, quand même je ne le veux point. Or, rien ne vaut, qui ne vaille par sa force. Tolstoï en est la preuve vivante. Cette vie incomparable est celle d’un violent. Qu’il en convienne : c’est en violent qu’il combat la violence. Entre celui qu’il veut être et l’homme qu’il est, il y a cette différence émouvante, que l’homme humble et doux qu’il veut faire de soi, n’eût jamais voulu, ni même pensé, à dépouiller entièrement sa nature. Il fallait donc ce violent, ce pécheur, pour rêver d’une vie sans péché. Et voilà pourquoi il n’est point de plus grave difficulté à la doctrine de Tolstoï que Tolstoï même.
IX QUE TOLSTOÏ N’EST MYSTIQUE EN RIEN
S’il y avait quelque mysticisme en Tolstoï, ce serait celui de la raison. Il s’en rapporte volontiers à des lumières naturelles, pour éclairer l’homme et lui montrer la vérité. La foi qu’il a, au pouvoir du bon sens et à la raison non corrompue, on peut l’appeler mystique. Il croit qu’un esprit simple, non gâté par la vie, reçoit la vérité sans peine, et l’accepte, comme l’œil sain fait les objets visibles. Le faux jugement lui semble un effet de l’erreur sociale ; mais, selon lui, l’homme sans malice n’v est pas sujet ; et enfin, nul homme d’intelligence ordinaire, pourvu qu’elle fût intacte et non viciée par la culture du mensonge, ne peut refuser son adhésion à l’Évangile, si on lui enseigne la parole de Jésus-Christ, dépouillée de toute théologie et de tout ornement ecclésiastique. L’Oriental, comme le Grec, est porté à confondre l’esprit et le caractère. Tolstoï pourrait se donner en exemple : quand il a compris la doctrine du Christ, il a été chrétien. Il ne conçoit pas qu’on balance à le faire. Il n’entre, peut-être, pas du tout dans la pensée d’un Montaigne ou d’un Renan, qui, comprenant la vie chrétienne exactement à sa manière, y verrait une raison suffisante de ne pas s’y conformer.
Tolstoï croit une idée bonne, parce qu’elle lui paraît vraie. Il ne faut que lui prouver la vérité d’une doctrine pour l’y faire adhérer. Dans le temps où, désespérant de la foi, il vivait dans la critique, souvent il a fait du bien la pierre de touche du vrai ; à cette époque, l’apparence d’une vérité se dissipait à ses yeux, ne laissant voir qu’une idée fausse, en ce qu’elle n’était pas bonne. À vrai dire, il n’a jamais été amoureux des idées pour elles-mêmes : il leur demande ce qu’elles ont pour la vie. Quand son esprit s’épuisait en efforts critiques, il lui semblait ne pas vivre. Plusieurs fois il a songé à se donner la mort. Il le répète volontiers, comme on parle d’un danger ancien, d’où l’on est sorti heureusement, et où les autres peuvent trouver matière à s’instruire. Quand il dit qu’il a été nihiliste, il ne faut pas le prendre au mot. Il était dans le doute, entre des idées contraires, dont pas une n’importait directement au bien, ni à la vie bonne. Voilà pour Tolstoï un état mortel, et de néant. Montaigne y voyait toutes sortes de commodités pour bien vivre.
Il est clair que Montaigne n’est pas un négateur décidé : mais le probable, dont il s’accommode, paraît à Tolstoï un pur néant. C’est que Tolstoï est de ces hommes surtout sensibles sur l’article de la morale, et qui n’en acceptent une que par relations avec l’ordre universel. Il leur faut la foi, à toute force ; car, sans la foi, il leur semble n’avoir rien. Tel est l’inconvénient, pour l’intelligence, d’être plus passionné qu’intelligent, ou, du moins, de laisser les passions gagner le seuil de l’entendement.
Mais Tolstoï ne conçoit qu’une foi humaine, directe aux intérêts humains, et dont la vérité oblige. Il revient à dire que Tolstoï ne doute pas de la vérité. Son évangile est tout rationnel. Sa morale est socratique : montrer aux hommes où est le vrai, c’est leur donner le bien, et les y forcer en quelque sorte. La guerre au mal est une critique de l’erreur. La vertu n’est que la vérité en action. Tolstoï est un sage, à la manière des anciens. Les saints de l’Antiquité — et chez les Hébreux même — sont des hommes plus intelligents que les autres, dont la saine intelligence découvre des vérités utiles à tout le monde. Tolstoï ne demande la foi ni à Dieu ni à la prière ; il ne l’attend pas de grâces surnaturelles. Lisez l’Évangile, comprenez la pensée de Jésus-Christ : c’est la simplicité, le bon sens, la vérité même. Quand vous en serez là, vous ne sauriez manquer d’être chrétien ; si vous êtes sincère, le salut est en vous. Il ne vous reste qu’à ranger votre vie à des principes que vous éprouvez vrais. Si vous balancez, la sottise est plus forte en vous que la faiblesse, ou la lâcheté. Votre bonne volonté n’est pas si en défaut que votre intelligence. Vous êtes malade d’esprit, avant toute autre infirmité. Guérissez-vous d’abord de votre complaisance pour vos maladies. Car la vie, que vous n’osez quitter, elle est affreuse et désespérée pour vous-même, autant que détestable en ses conséquences. Vous le savez bien : vous ne seriez pas homme, si vous l’ignoriez. Mais vous connaissez votre mal ; et la connaissance de la vérité, qui en est le remède, vous en purge, pour peu que vous ouvriez les yeux.
Pourquoi n’a-t-on pas la vue meilleure, pour voir la vérité ? Pourquoi n’en a-t-on même pas le désir sincère ? — Voilà une question obscure. Tolstoï tend bien plus à rendre la société responsable de cet aveuglement que chaque membre en particulier. Presque toujours, ceux qui font grand crédit à la raison, ont un jugement optimiste de l’homme et de la nature. Ils ne les ont pas en aussi profond mépris qu’ils méritent, et qu’il le faudrait. Quel étrange chrétien semblerait Tolstoï au moine de l’Imitation ! Quel prodige lui serait cet évangile socratique ! Il démontre le bien et la vérité chrétienne, comme Xénophon explique le bien et la vérité selon Socrate. Encore, Socrate a-t-il son démon.
⁂
L’inspiration de Tolstoï est plus positive : ni démon, ni extase, ni grâce, ni ombre d’un pouvoir mystique. Tout ce qui y ressemble donne du dégoût à cette âme puissamment rationnelle : un certain mysticisme du cœur, dont les fils de la femme ne guériront pas, s’il est un mal, irrite Tolstoï. Sa pitié et cet amour qu’il prêche entre toutes les créatures sont plutôt rudes, violents, pleins d’exigence, que trempés de douceur et de larmes. Il ne se reconnaissait point dans ces larmoiements et ces fadeurs dolentes, dont on a tant parlé, — et cette religion pitoyable, dont on a fait une mode. Il est même injuste, pour ce piteux répit, que des âmes, pauvres en tout, donnent à leur égoïsme, quand elles pleurnichent, et font l’aumône, fût-ce par ostentation : il faut leur en savoir gré, au contraire, comme d’un brin d’herbe, né de la boue et du sable ; aussi bien, n’est-ce pas assez pour y prendre garde. Tolstoï a trop fait l’expérience de la charité commune, des aumônes et de la philanthropie. Il y a touché du doigt la plus perverse vanité du monde : car où en est-il une plus fausse, plus riche en erreur, plus satisfaite d’errer ? Elle nuit à celui qui la fait, comme elle déprave celui à qui elle est faite. Elle est ce comble de mensonge, où il se crève les yeux pour ne point voir. Elle agit au nom de l’amour, et n’engendre que la honte et la haine. Peu s’en faut que la philanthropie d’habitude ne soit la maîtresse erreur de ce monde. La main y est pour trop, où le cœur n’y est pas pour assez ; de là, ce fatal divorce, où l’on finit par faire le bien, sans la moindre bonté.
Tout au moins, Tolstoï a bien raison de soutenir que la meilleure aumône est la moins calculée. Et, quant à en faire un moyen social, il n’a pas tort d’y démasquer une hypocrisie trop forte. Il est vain, en effet, de se flatter qu’une société malade, où l’aumône est mise à nu de la sorte dans ses infirmités, puisse se guérir par l’aumône. Mais si Tolstoï était plus sensible à la douceur du cœur humain, s’il goûtait mieux les pleurs de la tendresse, il ne se soucierait pas tant du bien social, ni de la vérité pratique.
Je ne sache pas que Tolstoï ait, nulle part, parlé de Jésus. La vérité de l’Evangile lui cache toujours Celui qui l’a dite. Il ne le nomme qu’en compagnie des autres législateurs sacrés. Qu’il soit un Dieu, qu’il soit un homme, on ne l’aperçoit jamais. Sage parfait, il enferme des vérités parfaites en quelques paroles. — « Qu’enseigne-t-il ? — Qu’a-t-il pour nous ? » — Voilà ce que l’Orient demande d’un prophète. Le Russe n’adore qu’en esprit : quel qu’il soit, un homme ne compte que pour un homme ; ce peuple se soumet volontiers à une foi ; il ne semble pas se soucier de celui qui la lui donne. Il est rebelle au Moi.
Ainsi, Jésus est absent de l’œuvre de Tolstoï, ce grand chrétien. Quoi de plus inattendu ? — Pour les hommes de l’Occident, ce paradoxe est presque incompréhensible. Ils seraient tentés de s’en plaindre. En France, en Italie, en Angleterre, Jésus a toujours été le grand vainqueur des âmes chrétiennes, et tout leur amour. Les plus saintes n’auraient pas été chrétiennes sans lui. La présence du Christ fit, pour elles, la vérité du christianisme ; son attente fit leur patience ; ses promesses firent leur salut. Ce nombre infini de larmes, de cris, de prières, de confidences ; ces appels de la mort et de la vie ; ces joies, détachées de tout, et ces douleurs, détachées de soi-même ; tous ces mouvements du cœur, depuis deux mille ans, ne sont pas allés à quelques paroles, fussent-elles les plus sages du monde. La force leur est venue de Celui qui les a fait entendre le premier. Le charmant François d’Assise imite son Maître jusque dans les marques de la croix et les stigmates du supplice. Le grand Pascal parle aux plaies amoureuses de son Dieu et ne l’eût point fait qu’à son Dieu. Pour le moins, que le chrétien ne voie pas seulement dans l’Évangile un recueil de maximes. Qu’il y laisse l’homme, s’il en ôte le Dieu. Et voilà Tolstoï qui, à force d’être humain, dépouille le christianisme de l’un et de l’autre, pour faire la place unique à la raison.
Par là, on voit assez que Wagner et lui n’auraient jamais pu se comprendre. Ils sont opposés, comme deux hommes ne sauraient l’être davantage : sentiments, vues du cœur et de la pensée, tout en eux est contraire. Ils sont aux pôles des mêmes objets. Ils ne sont pas possibles à concilier. Il ne faut pas s’étonner que Tolstoï juge Wagner avec une rigueur presque insolente. Plus Wagner s’est avancé dans les voies de son propre génie, plus il s’est enfermé dans les profondeurs du sentiment intime. Il a aimé Jésus, comme Michel-Ange a pu le faire : tout ce qu’il avait de divin lui-même est allé à la Personne incomparable, où s’est épanouie la forme la plus pure et la plus complète de la Divinité. Là où d’autres, même de l’humeur la plus religieuse, ne voient guère que l’homme en Jésus-Christ et n’y adorent de bon gré qu’une perfection humaine, Wagner a rencontré le divin. Wagner et ceux de son espèce n’en croient que le cœur, à cause des révélations qu’il se fait à lui-même. La personne divine est tout ce qu’ils aiment, et où s’élance le vœu de toute leur personne. Ils ne connaissent réellement rien que sous l’aspect de l’individu. Au plus profond de leur sentiment, ils diraient volontiers : « Plus il est Dieu, plus il est lui-même. Plus il est Dieu, plus il est grand, et plus je le connais. Plus il est Dieu, plus il me touche. Un homme ne peut être assez pour moi. Les souffrances d’un Dieu, qui veut être homme, voilà pour mon cœur l’émotion irrésistible. Combien, s’il est Dieu et s’il souffre, il est plus beau que s’il est homme ! — Cela ne se compare pas. »
Tolstoï, fidèle à l’esprit de sa race, cherche en tout ce qu’il y a de plus général et de plus voisin du commun. Mais il en est qui cherchent en tout ce qu’il y a de plus particulier et de plus divin. Ni ils n’ont le génie moins humain, quoi qu’il semble, — ni ils ne sont moins hommes. Peut-être sont-ils poètes plus qu’ils ne sont apôtres. Et peut-être, en effet, les apôtres et les prophètes ont-ils été plus semblables à Tolstoï qu’à Wagner. Cependant, Tolstoï ne rend pas justice à cette puissance d’amour qu’un Wagner déploie : elle aurait pu l’éclairer sur la nature de ce génie. Car enfin, cet extrême amour du divin gagne Wagner à Jésus-Christ. Comme tout amour, il l’engage au service et à l’imitation de l’objet aimé. Les préceptes de l’Évangile, quand même Wagner ne les suivrait que par caprice du cœur, il ne les offre pas moins à l’exemple de tout le monde. Il y a toujours du prince dans le grand artiste : mais, je le veux, s’il pense d’abord à lui, le bien qu’il propose n’est pas inutile aux autres. Wagner, se donnant à l’amour de Jésus-Christ, a ému, en faveur de la vie divine, une foule de gens dont la vie assez basse ne semblait plus capable d’une émotion si haute. Le chant, où tout ParsifaI s’appuie, où le mystère de la Rédemption s’offre d’abord, et sur lequel il doit s’accomplir, — a le caractère d’une révélation. Il porte une grâce, il a une puissance de religion que Tolstoï peut nier, s’il lui plaît, et s’il y demeure insensible, mais qu’il ne peut empêcher beaucoup d’hommes d’avoir senti. L’art a fait ce miracle. Il ne l’eût pas moins opéré s’il était possible que Wagner eût rencontré une mélodie si divine ailleurs qu’en son cœur, rempli d’un sentiment divin. Que Tolstoï en conteste la beauté : l’effet en demeure ; il ne dépend pas de lui.
Le grand artiste s’immole entier à son œuvre, après tout ; et il ne juge pas nécessaire de faire au monde un autre sacrifice. En est-il un plus rare ? Tolstoï n’en devrait pas douter. La vraie sainteté n’est peut-être pas si difficile que l’art véritable. François d’Assise n’est peut-être pas si unique que Beethoven. Faire l’aumône de soi, toute sa vie, à des misérables, et se donner sans compter à des œuvres sublimes, où les plus nobles créatures trouveront ce pain, que le blé ne produit pas, — ici ou là, quelle charité est la plus grande ? — Je m’imagine que Tolstoï est plus irrité de la puissance de l’art que de ce qu’il ne peut pas. Il est blessant, pour les apôtres, que l’artiste touche au divin, par les voies, en apparence, de l’égoïsme ; plus d’un en eût été découragé, s’il avait été mieux instruit. C’est pourquoi ils sont, le plus souvent, des hommes simples, au grand cœur, d’esprit fruste ; l’ignorance leur permet d’avoir en mépris ce qu’ils ne connaissent pas. Quand ils s’en vont, à Athènes, casser les statues à coups de marteaux, il est fort heureux que l’horreur des idoles, comme ils disent, occupe toute leur pensée : car, s’ils avaient quelque idée de Phidias et de Praxitèle, ils en comprendraient à demi les dieux, et ils ne les briseraient pas.
X
SUR L’HUMOUR DE TOLSTOÏ
Souvent Tolstoï renverse son ennemi par le ridicule. Son humour est irrésistible. Elle a ce caractère singulier d’être encore bonne, même quand elle porte des coups terribles. Il n’y a pas, dans Tolstoï, l’ombre d’une volonté méchante ; et quand le monde entier me ferait calomnie de lui sur calomnie, j’en croirais Tolstoï et n’en croirais pas le monde entier. Tolstoï a pu être mauvais, comme tout homme : encore y a-t-il des abîmes entre la méchanceté d’un homme et celle d’un autre. Nul ordre ne compte plus de degrés, depuis les infiniment petits de la mauvaise conscience, qui la trompent elle-même, jusqu’aux élans divins de la bonne. Il va de soi que la bonne volonté de l’esprit et le bon mouvement du cœur sont tout. Fit-il le mal, en Tolstoï la volonté est bonne. Il est admirable qu’elle le demeure, avec une vue si impitoyable des vices, des fautes et des ridicules humains. Mais c’est que Tolstoï ne voit pas moins au fond de la misère humaine : il a plus de raison même que de verve. Il est beau que sa charité dépende étroitement de sa raison. La sotte idée d’en faire un prêcheur de pitié ! Tolstoï est un des esprits le plus éloignés de tout rêve sentimental. La foi et un raisonnement complet ne sont pas loin de ne faire qu’un à ses yeux. Cette pitié, dont on se fait un peu partout un dogme, et qui en est un même pour la sensibilité des sceptiques, ne lui plaît guère, si elle ne le dégoûte. Tolstoï est réaliste en tout : il lui faut des réalités. La vraie pitié, à son sens, consiste en une vie pure et sans crime.
Il serait donc d’une ironie implacable, s’il n’avait toujours la volonté du bien. Voilà par où son humour, aussi forte que celle de Swift, est souvent innocente comme celle de Dickens. Mais Swift et Dickens, à eux deux, ne font pas encore Tolstoï : car ce démon de Swift et cette douce femme de Dickens, ne sauraient être unis dans le même homme, que par une vertu supérieure à tous les deux, — qui est le génie de cet homme. L’humour est l’alcool robuste, que distille un esprit assez fort pour se suffire, et qui se rit d’un objet, sans d’abord penser à en faire rire. L’humour est un effet âpre et violent d’une raison, qui raisonne directement, sans se soucier des raisons d’autrui. Elle va droit devant soi, et ne s’arrange ni pour qu’on l’excuse, ni pour qu’on lui prête plus d’attention qu’à ce qu’elle raille. L’humour ne moque pas : elle veut détruire par la raillerie. Elle est une sorte de raisonnement par l’absurde, manié par une pensée qui voit, et qui donne la vie du ridicule aux objets absurdes. L’humour est l’esprit d’une âme puissante en vérité. Les raisons de Tolstoï sont pleines d’humour pour la plupart des gens, parce que Tolstoï cherche toujours le vrai, s’attache au vrai seul, et n’omet aucun des éléments du vrai. La plupart des hommes accepte une vérité pour vraie, ou une erreur pour fausse, sans aller au delà. Tolstoï en démembre les réalités une à une ; et comme souvent ce qui passe pour vérité de fait est un mensonge à ses yeux, l’humour éclate de tous les points de la découverte.
XI
LE MOI
Il faut haïr le moi ; mais, d’abord, il faut le connaître, et qu’on le hait. On se trompe sans cesse sur ce fond de l’homme. On confond l’amour de soi avec la force, d’où il procède. L’égoïsme fait honte à l’homme de l’homme même. On mêle au sentiment de soi l’idée du tort que l’amour unique de soi fait aux autres. Enfin, on se sert de la morale pour avilir ce que l’esprit relève : car, bon gré, mal gré, jamais l’intelligence ne prendra parti dans l’homme contre ce qui fait sa force.
Tolstoï enfant est égoïste, comme tous les enfants. Il ramène tout à soi. La plupart des hommes fait de même ; mais elle se fait craindre ou haïr par là ; car l’amour-propre des uns se heurte à celui des autres ; ils se combattent ; ils s’envient ; ils se nuisent ; et c’est proprement en quoi le moi est haïssable au moi. Tolstoï, sous la figure de Bésoukhow et de Lévine, fait encore assez souvent l’effet d’un homme plein d’amour-propre. Mais, en dépit de ses violences, on ne peut ni le mépriser, ni le haïr. On l’aime, au contraire. Comme le moi des enfants se fait aimer, le sien n’est point odieux ; et, là même où il semble sans agrément, il est aimable. C’est que ce moi ne s’aime point. Avec tout son orgueil, sa violence et parfois sa brutalité, il n’a aucune complaisance pour lui-même.
Ici l’on voit comment ce que la morale condamne dans l’égoïsme n’est pas du tout ce qu’y connaît l’esprit.
Les égoïstes, selon l’opinion vulgaire, sont ceux qui n’aiment que leur intérêt propre ou le préfèrent à tout. Avec plus ou moins de conscience, selon qu’ils ont plus ou moins de cœur et d’esprit. Mais, d’un enfant plein de vie, où tout l’être est en croissance, l’âme avec le corps, et la volonté propre comme le rôle marqué par le destin, on ne peut dire justement qu’il est égoïste. Il accroît et développe sa force. S’il n’en avait une, qui le défend contre la masse de l’univers, il ne pourrait jamais la porter à ce point de grandeur où quelques hommes ont atteint, et où ils ont su en faire le sacrifice à cet univers même. Ce qui est vrai de l’enfant l’est de certains hommes, et du génie. On appelle égoïsme ce qui n’est, en eux, que l’effet de leur force, sans quoi ils ne seraient pas ce qu’ils sont ; ni capables surtout, le jour venu, d’un parfait sacrifice. En quelque sorte, on ne peut immoler que ce qu’on a le plus. On n’est prodigue que de sa fortune. Il faut un moi bien plein, grand et fort, pour un amour des autres grand, plein et fort. Et, enfin, il faut être égoïste, ou le pouvoir, pour pouvoir aussi ne pas l’être.
On condamne le moi sur l’arrêt que l’amour rend contre l’égoïsme. Mais c’est confondre les espèces ; car l’égoïsme est l’objet d’un jugement moral ; et le moi ne dépend que de la connaissance intellectuelle. Or, l’intelligence ne peut blâmer ce qu’elle sait être le puissant ressort de toute force pour le bien et pour le mal. Puis, l’esprit qui connaît véritablement ne condamne point. Condamner, c’est ne connaître pas.
⁂
Le Moi est le nœud de la force. Sans le moi, l’homme est une faible créature, qui n’a rien pour elle-même ni pour les autres. Sans un moi puissant, l’homme ne peut rien. La foule des hommes n’est que faible : et leur égoïsme confesse leur faiblesse.
Ils n’ont que de petits intérêts ; et il est naturel que ce soit uniquement les leurs. Ils ne sont capables que d’un très pauvre amour ; — et c’est celui-là qui est l’amour-propre. Ils ne sont pas égoïstes, parce que leur moi est grand ; mais il faut dire que leur moi est tout égoïste, à cause que leur moi est petit. Si l’égoïste était celui dont le moi est puissant, il faudrait croire que de tous les hommes le grand égoïste est le moins sujet à ce qu’on nomme égoïsme. Apprenez à réconcilier la grandeur de l’âme avec le cœur : il n’y faut, peut-être, qu’une divine imagination.
L’amour de soi et la force du moi ne se doivent donc pas confondre. Il est d’un dommage continuel, pour la raison, de ne point distinguer des objets si contraires. Que faire d’une âme sans force ? — Encore bien moins le meilleur que le pire des hommes. On n’aura jamais assez la crainte de la médiocrité du cœur. Il est vrai : le moi puissant ramène tout à soi, ou le semble ; comme l’enfant, il est le centre de l’univers : mais admirez qu’il puisse être celui des caresses. Il y a une plus belle vertu qu’on ne croit dans l’art qu’on a de se faire aimer. Et quoi qu’en disent les roués, — qui se fait beaucoup aimer, même s’il feint de n’aimer pas, il aime. Les roués, en conduite ou en esprit, ne voient que le moindre côté des choses. Ils ne connaissent que l’amour charnel. Mais le vaste amour de l’univers, l’idée même leur en est étrangère.
Ainsi, orgueilleux, violent et passionné, Tolstoï, qu’assez bassement on a dit égoïste, n’est égoïste qu’au sens où il a l’âme puissante, qu’il le sait, et qu’il ne cache pas cette puissance. Supposé même qu’il l’oppose brutalement à la faiblesse d’autrui, ce n’est point égoïsme en lui, mais force. Ce l’est pourtant en vous. Veut-on que l’homme le plus fort du monde soit docile, humble, souple d’échiné, prompt à céder, sans instinct de domination ? — Mais, quand il devrait l’être, le pourrait-il, sans cesser d’être ce qu’il est ? — Ou attend-on de la force la plus grande qu’elle soit faible en effet ? — Elle pourra vouloir l’être ; elle pourra se donner un jour cette loi ; et jamais elle ne saura s’y plier.
Je sais que ce moi puissant effraye. Quand il a marqué ce qu’il veut, et qu’il y applique sa force, elle se fait jour avec violence. Elle n’a pas égard à ce qui l’arrête ; elle y va contre, sans mesure, quelquefois même sans pitié. Elle renverse les obstacles ; elle les broie ; ou le médite. Elle est pleine de heurts pour tout le monde ; elle semble insolente, et elle n’est pas toujours sans cruauté. La grande pluie d’avril, qui fait lever les blés, noie une foule d’insectes ; et ces bestioles se plaignent d’une telle injustice. Mais le pain de la vie est à ce prix. Jésus-Christ n’est pas sans pardon ; mais il est sans mollesse pour les pécheurs endurcis. Les marchands du Temple l’ont dû juger violent et égoïste. La force est à toutes fins. C’est pourquoi elle peut avoir de mauvaises apparences. Mais ce qui en est l’âme, et qui l’est du moi puissant, est la source de tout bien.
Cette force, enfin, reste obscure en son dessein à la plupart des hommes. Ils la calomnient, parce qu’ils la craignent. Ils en sentent seulement la présence ; et, tant qu’ils ne sont pas sûrs qu’elle ne tend pas uniquement à leur nuire, ils la détestent, parce qu’ils l’en soupçonnent. Un grand moi passe aisément pour haïssable auprès de tous les moindres. S’il l’est, c’est en ce qu’il n’est pas grand. Encore préfèrent-ils se voir contraints d’y céder, à pressentir qu’ils devront le suivre. Il les humilie ; mais l’humiliation imposée à tous n’est plus si dure, et à la fin c’est une gloire subie.
Qu’ils s’en fient pounant à ce moi qui les domine, même s’il en a l’orgueil, de n’aimer pas sa domination. Ni surtout le fond caché qui l’a pu taire. Une tristesse invincible y est liée, comme Andromède au rocher battu de la vague. Il le sait bien, ce moi, et qu’il ne cesse de se haïr, que s’il se donne tout à ce qu’il aime, en parût-il le tyran.
Pendant longtemps il est à charge à tout le monde, et plus encore à lui-même, ou il le reste. C’est tant qu’il ne sait où s’exercer. Alors, il a beaucoup du commun égoïsme, du moins par le dehors. Il est brusque, irascible, mécontent de tous, d’apparence jalouse et querelleuse, dur et prompt à abaisser autrui, abondant en caprices, et, en fin de compte, avec un violent désir de s’imposer aux autres, réduit à les fuir sans trêve, pour ne trouver du reste aucun contentement en soi-même. Tolstoï a paru pendant trente ans un homme insociable, tour à tour misanthrope et enthousiaste ; un esprit bizarre, tantôt hanté de chimères morales, et tantôt réaliste, rigoureux et pratique, presque insensible de parti pris ; comme un gentilhomme campagnard d’Angleterre, épris de jeux violents et d’économie rurale. Il aimait les courses et la chasse, les chevaux et les combats de coqs ; il était plus chaste par timidité que par froideur naturelle. Toutefois, comme quelques hommes le sont, passionnés d’amour jusques à la volupté charnelle, la femme avilie et la caresse vénale les dégoûtent trop pour les laisser sensibles au plaisir même qu’ils y prennent. La pitié de leur mère les prend dans la souillure de cette chair souillée ; et la femme, qui sommeille enchaînée dans le cœur triste de chaque homme, se fait alors connaître, comme une mère, par ses larmes. La pitié et la chasteté se tiennent par la main, divines et douces prisonnières, retenues aux murailles de la caverne ; et leur parenté est un grand mystère. — Enfin, ce n’est pas seulement parce qu’il y réussissait peu que Tolstoï n’aimait pas le monde : c’est qu’une viande aussi creuse ne pouvait satisfaire la faim sauvage de cet esprit. Puis, nul homme, au milieu même de la débauche de la vie, n’était plus prompt que lui à la pudeur[3]. Enfin il se jetait parfois, tête baissée, au fond du dégoût, pour l’oublier. La honte de vivre a son ivresse.
⁂
Quelques-uns disent qu’il est resté cet homme- là, et qu’en lui tout est volontaire, surtout la vertu.
Ils n’en voient que les apparences, sans le connaître plus en ce qu’il est qu’en ce qu’il fut. Le fond du cœur est le même, et il est admirable qu’on n’en puisse pas douter. De tout le fer qu’il avait pour le mal et pour la guerre, il a fait une charrue pour le bien et pour la paix. Ce Moi puissant enfin a trouvé sa vérité. La volonté seule fixe le sens de la force.
Tolstoï était sans cesse irrésolu et indécis. Sa volonté n’avait pas d’emploi. L’immense labeur qu’elle pouvait fournir dépendait de la raison, qui devait seule en régler l’usage. Il lui fallait la vérité, ou, comme on dit, une foi.
Il l’a eue. Dès lors, en lui tout a eu sa règle. Ce que cette force avait d’unique pour le bien et pour la vie s’est révélé.
Sa critique minait toute créance. La vie et la pensée lui semblaient justement inutiles ; l’action et l’amour, sans objet. Il a dû paraître plus égoïste, quand il a embrassé un objet unique ; qu’il en a défini l’utilité suprême ; qu’il s’y est attaché de toutes ses forces, et a voulu y engager l’humanité entière. Il n’est qu’une grâce : non pas même tenir la vérité, mais être la vérité. — Que sera-ce d’un homme sans vérité ? Sans unité ? c’est-à-dire enfin, sans moi ? — Un filet d’eau qui passe, en mirant des feuilles qui bruissent, et qui tombent, desséché par un peu de soleil plus tôt qu’elles ne sont tombées. Sort dérisoire ; plus dérisoire encore qu’on puisse s’en contenter. Il y a de pauvres hères de savants, qui se tiennent pour les plus grands esprits du monde, et se jugent, avec gaîté, un jeu de sensations sans aucun lien : qu’ils se croient les meilleurs, en outre, c’est ce qu’il y a de plus bouffon. Il est doux de voir ces docteurs se faire justice, et qu’ils sont pareils dans leurs laboratoires à des Patagons sur leurs pirogues, dans le canal de Magellan, — ou même mieux, qu’ils ne diffèrent point d’un polypier. Il est vrai sans doute ; mais qu’ils s’en contentent...
Sans le moi, il n’y aura pas de vraie morale. Il faut porter le moi au plus haut, dans une perfection entière, pour le parfaitement immoler. Voilà la morale. Les docteurs et les savants de trois kopecks n’auront jamais de morale. Ils n’y ont aucun droit. Ils n’ont besoin que d’arithmétique, et de balances. Leur moi pèse justement ce que pèsent leurs doigts : il est bien connu que ce ne sont que des millièmes de milligramme. Un docteur très docte méprise toute pesée au-dessus de ce poids. Que j’aime les voir se rendre justice.
⁂
Voici donc les termes d’une grande conscience : où il n’y a point d’amour de soi, il n’y a point d’égoïsme, et fût-ce dans le moi le plus tyrannique du monde. Il n’est pas égoïste, ce moi, qui ne peut se passer d’amour divin, et du bien où il se perpétue à l’infini, comme l’espèce dans le désir. Une faim ardente d’immolation y trouve son aliment, et, comme le désir, le moi se jette dans son cher abîme. Les générations de l’âme sont bien plus enivrantes que celles de la chair ; et le moi s’y précipite.
La lumière du jour ne donne pas d’elle-même des preuves plus fortes, que Tolstoï de ce caractère. Il a le besoin perpétuel d’amour. Il a le regret de la parfliite innocence. Il a cet appétit de la vérité universelle, dont s’aiguise la faim de l’immolation. C’est alors que le vrai est le bien ; et le bien, l’amour de toutes les créatures.
Qu’ensuite il plie son caractère tant qu’il voudra ; qu’il contrarie ses mœurs, et rompe ses goûts. Quelle petitesse de croire, là-dessus, que la volonté y est pour tout : elle n’y est que pour le monde et la vie, qui ne sont rien ; mais en rien, pour le fond même du moi, qui est tout. Et d’abord, qu’est-ce qu’une volonté hors de la nature ? On ne veut que comme l’on est.
La volonté, dans Tolstoï et ceux de son ordre, dépend étroitement de la raison. Quand il sait ce qu’il doit vouloir, il le veut aussitôt. La volonté est une vue profonde et vaste de l’univers. Il n’y a guère partout que des aveugles. Ils s’agitent honteusement ; et ils s’imaginent qu’ils veulent. Et on le croit. Spectacle qui fait pitié.
Tolstoï, encore une fois, en juge comme Descartes et les anciens : c’est une bonne tête ; mais qui veut être la servante, sans repos, de l’amour : Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Il veut selon son cœur enfin, et non selon ses habitudes, ou celles que le monde a pour nous. Il nie qu’il soit bon, comme tous les moralistes ; et il en est sûr, comme bien peu : cette idée ravit. À l’égal de chaque grande conscience, il voit combien il aurait pu taire de mal, s’il n’avait eu le bien. C’est le secret superbe de l’humilité des âmes orgueilleuses.
La religion de Tolstoï tue le moi : elle l’a d’abord vivifié. Est-ce donc qu’il faut le tuer ? Un si terrible meurtre est-il tout à fait nécessaire ? — Plus Tolstoï le dit, plus je vois combien le sien est grand. Les petits égoïstes ne pensent jamais à tuer le moi : tous les hommes sont de petits égoïstes. Or, c’est eux qui doivent tuer le moi, et s’instruire à perpétrer ce suave meurtre. Quant à Tolstoï, il est un maitre en cet enseignement : ne vous inquiétez pas s’il le suit, pourvu qu’il vous apprenne à le suivre. Si Tolstoï et ceux de sa sorte accomplissaient ce meurtre du moi, ce serait briser le nerf du monde.
Les Saints conduisent l’homme. Aussi, ils s’en méfient et le méprisent. Il ne leur reste qu’à l’aimer. Et infiniment mieux qu’il ne s’aime. Ils le mènent donc à tuer le moi. En efi’et, les petits n’ont rien de mieux à faire. Ils ne peuvent diriger ce moi, sous le fouet de la perfection, vers le bien et le plein sacrifice. Qu’ils le tuent donc. Qu’ils aient peur de le nourrir.
Cette force du moi, il faut une main puissante pour la brider : Comme Pégase qui emporte le char du soleil, par où le monde reçoit la lumière et la vie : Si c’est Phaëton qui tient les rênes, tout se brise ; il sème l’incendie et la mort. Si c’est le dieu, le char parcourt la belle carrière : il l’a en main. Le dieu ne pense plus, un seul instant, que Pégase ne lui ait été donné que pour lui-même.
Guidant le soc, derrière le bœuf patiemment courbé sous le joug de la vie, Tolstoï s’avance le long d’une semblable route. Ni la mort, ni le désespoir de la vie ne l’occupent plus : il n’a pas le temps. Il a des hommes, qui faire vivre ; du pain à porter aux peuples en famine ; des enfants à nourrir ; des sourds à qui rendre le son de la vérité, et tous ces aveugles à qui la faire entrevoir. Ses seuls doutes sont pour lui-même, et ses frissons. Voilà son égoïsme. Il a des disciples. Il est si resplendissant de foi, qu’il ne se sépare plus d’elle ; et sans doute ses fidèles ne la séparent pas de lui. Il ne parle plus pour ce qu’il dit : mais pour ceux qui l’écoutent. Hommes comme lui, il les fait plus hommes. Il est humain, presque seul dans cette espèce, dont l’humanité est le rêve troublé, douloureux et lourd, sans cesse étouffé par un sommeil accablant, dans son lit de ténèbres.
Et quand il triomphe dans son action, ce grand moi se supprime.
XII QUEL HOMME IL EST SELON LUI
Jamais homme ne parla de lui avec moins d’indulgence : car il ne s’accable même pas ; il se rend justice ; il ose se traiter avec vérité. Aller jusqu’à être vrai avec soi-même, — courage étonnant, qu’il a eu seul, peut-être, avec Montaigne, qui, pourtant, y met quelque coquetterie. Tolstoï semble se regarder avec les yeux d’un autre, — d’exquise sensibilité pour tout voir, — et d’un jugement détaché jusqu’à l’insensibilité parfaite. Des portraits de Tolstoï par lui-même, à ceux des autres, il y a la même différence que de ceux de Vélasquez aux portraits des autres peintres. C’est la vie offerte aux yeux, — et qui se donne à juger. Rien n’indique le sentiment de l’artiste. Il a tout aperçu ; il tait tout apercevoir ; mais, comme la vie même, il n’exprime pas le jugement, qu’elle implique toutefois. Ainsi, l’on peut différer de sentiment, en présence de ces images, comme devant la créature vivante. Taine a dit d’Innocent X, tel qu’il est à Rome, au palais Doria, toute sorte de faussetés, selon mon goût. On ne s’accorde qu’à convenir d’un talent miraculeux ; Vélasquez n’a pas laissé là un portrait de ce Pape, — mais le pape Panfili en personne.
Tolstoï traite ses personnages avec la même liberté dominatrice : il n’est pas croyable qu’il en fasse autant de soi-même. Le génie de Montaigne, qui décompose et qui analyse sans cesse les éléments d’une vie, est tout opposé, dirait-on, au génie de Shakespeare, qui ne se lasse pas de créer des êtres vivants, par un prodige de force et de sensibilité, où la raison jugeante semble ne pas avoir de part. Le fait est que Montaigne était le philosophe de Shakespeare : il le lisait assidûment. Et le fait est encore qu’il n’y a point de portrait de Shakespeare par lui-même. — Tolstoï, qui n’intervient jamais dans son récit, pour le compte de ses personnages ; qui ne loue ni ne condamne ; qui laisse parler uniquement la vie ; — ne paraîtrait pas devoir s’être pris pour modèle. Or, il l’a, au contraire, toujours fait. Il a ce don extraordinaire de se voir dans tous les détails, et dans les plis les plus secrets de l’àme, — sans jamais se reconnaître. Il ne se quitte, pour ainsi dire, point, — et n’est pas à soi-même attaché. De là, cet air incomparable de vérité mis en tout. Les Anciens nous peignent ainsi la simplicité grecque, Œdipe, Ulysse, Philoctète ; mais ils ne se sont jamais peints.
Point d’image de Tolstoï, qui vaille donc celles qu’il en a données. Il n’est que d’aller à son œuvre, et de les y prendre. On le suit de l’enfance à la vieillesse. Il n’y manque pas, non plus, les traits du visage. Ce n’en est pas un des moindres mérites, que ce portrait ait été tracé peu à peu, avec le temps, au cours d’un demi-siècle. Rousseau vieillard parle de Rousseau jeune homme. Mais c’est Tolstoï jeune homme, qui peint Tolstoï adolescent. Outre les dons d’une mémoire admirable, Tolstoï, s’observant sans relâche, n’a pas remis à plus tard de fixer ses impressions.
Ses Souvenirs d’Enfance sont le seul livre, au monde, où l’àme et l’esprit de l’enfant s’offrent aux yeux, comme on les trouve dans le regard, le sourire, les caresses, les paroles de l’enfant. Nulle ironie : elle est trop déplacée en la matière. Nulle comparaison à l’âge mûr : elle détruit cette fleur impalpable de la naïveté. Et nulle affectation de puérilité : c’est un jeu qui sent le vieillard. Un tel ouvrage, avec le charme du chef-d’œuvre, à la portée d’une étude unique pour la science. La confidence de l’être enfantin, que nul enfant ne fait, parce qu’il manquerait précisément à l’enfance, s’il pensait à la faire, — Tolstoï l’a faite. Qui veut connaître les idées de ce raccourci d’homme, tout barbouillé encore du lait de la femme, sa méthode sentimentale, sa logique propre, absolue et instinctive, son être passionné et léger, où les pensées mêmes se jouent à l’état d’émotions, — n’a qu’à lire ce livre, — et n’a, du reste, à lire que celui-là.
Dès le début, on voit une nature puissante, rebelle à toute contrainte, sinon l’amoureuse, qui porte à l’extrême limite les forces mises en elle : avant toutes, une sensibilité en continuel mouvement, une sincérité de cœur qui n’a d’égale que la sincérité de l’esprit. Il éprouve, avec une rare plénitude, les alternatives de la vie sentimentale, — et d’abord les sentiments tendres. Mais il paraît les juger avec non moins d’ardeur, qu’il les sent : enfant ou homme, il applique tout ce qu’il a de réflexion aux intrigues, par où son cœur et son âme passent. Il est curieusement avide de se rendre compte de lui-même et des autres. Le goût de la vérité lui est, de bonne heure, si intime, qu’il se confond entièrement avec le goût de la justice ; et, si cette disposition est enfantine, il n’a pas cessé d’être enfant sur ce point. Il souffre, jusque dans l’âge mûr, de cette timidité ombrageuse, presque maladive, qui est comme la peau presque toujours froissée à nu, d’un amour-propre toujours blessé. Il semble n’avoir jamais été content de lui. Sa manie de raisonner l’a éloigné de tout le monde : car, dans une âme violente, raisonner c’est vouloir avoir raison. Bientôt, les autres hommes nous font l’effet de ne vivre que d’à peu près, et de n’aller au fond ni des idées, ni de ce qu’ils sentent. S’il arrive qu’on attache une valeur morale à l’examen de sa pensée, — le peu de profondeur qu’on voit à l’intelligence d’autrui, vous en dégoûte plus que ne feraient même de graves fautes. Beaucoup de grands amis de l’Humanité ont été misanthropes pour cette raison.
Tolstoï n’est pas indulgent. Un amour ardent de la vérité ne va guère avec l’indulgence : il faut la laisser aux âmes molles, ou à celles qui sont revenues de tout, et de la vérité même. Tolstoï ne s’abandonne de bon gré qu’à la terrible innocence de la nature : il ne discute pas avec elle ; de là, que les plus simples créatures l’ont conquis et retenu : les enfants, les hommes du peuple, les paysans, les bêtes, les arbres, et les femmes pures. Sa mère est la seule personne de sa famille, avec une vieille servante, qu’il n’ait jugée que du fond de son amour. Son esprit démonte les ressorts de tous les autres êtres, de ceux-là même qu’il aime le plus : d’un frère, d’une femme, de sa sœur, de ses enfants. Il ne les flatte point parce qu’ils lui tiennent ; mais plutôt il les dessert, parce qu’il les connaît mieux. Sa sincérité brutale le pousse à montrer cette cruelle connaissance, qu’il pourrait cacher. Il est bien difficile, ayant une vue perçante des hommes, et un cœur assez entier pour ne pas les ménager, de ne pas se faire, à la longue, une espèce de mérite d’être sans ménagement. L’orgueil nous dupe où il veut. Puis, il faut en convenir, la connaissance des hommes en inspire le mépris ; et l’habitude d’être vrai ne va presque nulle part avec la politesse. On ne se police, qu’à force de mentir. Les victimes d’un grand homme à l’humeur rude ou morose, devraient la lui pardonner, en partie, s’ils savaient de quel prix il la paye : le don funeste de pénétrer les caractères, et d’en discerner les mobiles, n’est pas un jeu : ne s’y amusent que des âmes assez légères, eussent-elles beaucoup de poids par ailleurs. Au surplus, il n’est pas possible de ne point taire d’amers retours sur soi-même : cette faculté d’une seconde analyse, où la connaissance des autres vous rejette à vous seul, est proprement la revanche du cœur sur l’intelligence. Il n’est pas d’homme aimant sans cette faculté des retours. Elle est le signe qu’une vaste imagination ne s’arrête point à ses conquêtes ; elle passe de là au conquérant ; et s’acharne sur lui à de nouvelles découvertes.
Voilà où réside la source du bien : c’est une compassion des autres, qui nait du dégoût de soi, où l’on fut conduit par le dégoût d’eux. Un Tolstoï a toute la capacité qu’il faut pour contenir un mal presque illimité : il y pourrait être puissant ; je m’assure que souvent il lui en souvint. Mais la compassion l’en empêche ; elle le défend de cette violence sans pitié, où le mépris d’une intelligence, qui ne se peut refréner en ses jugements, nous entraine contre les objets de son dédain. Tolstoï a fui les hommes, par accès, à toutes les époques de sa vie, quand il avait 15 ans ; quand il en avait 30 ; Lévine est une sorte de solitaire : c’est qu’il les aimait ; par crainte de les juger et de les haïr. Il n’était pas agréable à ses parents, ni à ses amis. Il n’en a eu qu’un, au temps de la première jeunesse, où l’on aime son ami à la manière d’une maîtresse ou d’un amant, sans qu’on ait, pour se quitter, la ressource des trahisons charnelles. Et Tolstoï a fait un tableau lamentable de cette amitié, où les esprits devant seuls se déprendre, il y a toujours l’un des deux qui va au-devant, et qui dupe l’autre : celui-ci prête à celui-là toutes les perfections, qui se les laisse prêter, et ne pardonne point ensuite aux yeux dessillés par lui-même, de ne les lui plus trouver.
Sensible à l’excès ; prompt aux larmes, comme peu d’hommes le sont, moins par tendresse de cœur que par rapidité d’imagination ; plein d’amour-propre, et ne s’aimant pas ; d’une vivacité extrême d’esprit, de cœur, de parole, de geste, mais non de résolution ; non moins timide que violent, selon que son amour-propre le bride, ou qu’il en rompt l’entrave ; insatiable curieux des sentiments et des mobiles humains ; malgré lui, juge absolu de ce qu’il analyse ; témoin défiant qu’on ne trompe, ni ne corrompt pas ; raison toujours armée contre la vanité de l’homme, et qui se désarme elle-même, en en touchant le fond ; très instruit des passions, très propre à en éprouver de fortes, dont la connaissance et la crainte accroissent beaucoup la force ; avide d’amour, et incapable de ne pas peser ce qu’il aime ; sans patience ; uni au monde entier des créatures sans pouvoir accepter le commerce des hommes comme ils sont ; fort jaloux de tendresse ; implacable au mensonge ; épris sur toutes choses de pureté : telle est la riche substance de ce caractère redoutable, dont l’équilibre ne s’est établi que dans la sainteté.
L’amour de la vérité a fondé cet établissement. Ceux qui aiment la vérité, et ceux qui n’en sont que curieux, font deux espèces différentes. Les curieux de vérité n’y mettent pas du leur : elle leur sert, esclave humiliée, pour l’excellent et pour le pire. Ceux qui aiment la vérité ont tous une morale : et ils l’auront tôt ou tard, si d’abord la vérité les fuit, et s’ils la cherchent seulement, pourvu que ce soit avec amour. Les règles pour la conduite de l’esprit suppléent longtemps aux règles pour se bien conduire. La pensée droite est une caution de toute sorte de droiture. Le premier usage d’une bonne pensée est de reconnaitre que l’homme n’est pas, comme on dit, « un empire dans un empire ». Et, de quelque côté qu’on incline cette pensée, dès qu’elle est sentie par le cœur, elle est le fondement de la morale. Pour l’amour, elle est une vérité de fait. Avec Tolstoï il en est allé de la sorte. Il a commencé par être tout à soi. Il s’est dégoûté de soi-même, et du reste, après s’en être épris par instinct, par devoir, par compassion. Enfin, quand il lui semblait que le monde fût vide, la vérité, qui ne l’avait point laissé se satisfaire d’une réponse médiocre, lui a découvert que le Bien était le plan réel de la compassion universelle. Elle l’a persuadé que ce Bien seul donne une réalité, à ce qui n’en a pas sans lui ; qu’il la crée incessamment ; qu’il est par là le divin, ou la réalité même ; et que, n’y ayant rien autre de vrai que lui, c’est pour lui seul qu’il faut vivre, puisque, lui ôté, il n’est point de vie.
XIII
GRANDE SOLITUDE DE TOLSTOÏ
Il y a une solitude plus profonde que la nuit arctique, plus étendue que la banquise du pôle. Il y a un désert plus vaste et plus immobile que la glace sur le toit de l’Asie, quand la lune de l’hiver l’illumine. C’est l’homme parmi les hommes ; et la volonté d’un seul homme, aux prises avec le monde durable et les jours éphémères, voilà l’abîme de Pathmos, où la solitude est parfaite.
Qui doit le savoir mieux que Tolstoï ? Le grand vieillard a voulu le règne de Dieu sur la terre, — et ce n’est pas d’aujourd’hui. Il a mis toute la force d’une logique puissante, au service de ce grand dessein. Il ne doute plus, depuis longtemps. Il peut s’en prendre, du moins, à la folie, à l’égarement des hommes, à la mortelle lenteur de la vérité, aux peines qu’elle a toujours eues à se faire une route. Car un Tolstoï vit, grandit, s’élève sans cesse pour cette vérité qu’il porte ; et, pourtant, son tour vient de vieillir, de voir la neige des ans couvrir peu à peu sa perspective ; et de regarder la tombe qui se creuse, et qui ferme l’étape à l’horizon.
La comtesse Tolstoï a dit un jour : « Le comte ne travaille plus pour la Russie, maintenant, mais pour le monde. « C’est quand on est le plus séparé des siens, qu’on se fait tout à tous ; et celui qui se quitte lui-même est plein de l’univers. Tolstoï a toujours été solitaire ; il est de ces hommes à qui il faut un trop grand espace : ils prennent tout l’air autour d’eux ; et à mesure qu’ils se répandent, ou ils attirent les environs, ou ils y font le vide. Il faut leur appartenir, ou les fuir. Il faut un peuple à Tolstoï. Puis il est rebuté d’eux ; il s’emporte contre leur mauvaise volonté : dans la Guerre et la Paix, dans Anna Karénine, et ailleurs, Tolstoï passe aussi souvent pour misanthrope que pour dévoué et charitable. Il leur demande trop, dit-on. Non : bien moins qu’à lui. Il ne leur demande que de le croire. — Il leur fait un faux reproche, dit-on encore, de ne pas lui obéir, de ne pas se laisser convaincre : mais pourquoi lui céderaient-ils ? — Parce qu’il est le plus fort ; qu’ils le savent ; et qu’il ne peut faire lui-même de ne le savoir point.
Tolstoï parle au monde entier, selon le mot de sa compagne. Mais c’est qu’il ne peut enseigner son peuple, ses voisins, ni même sa compagne. Que je le vois isolé ! Son isolement est aussi vaste que lui. Nul homme ne peut se vanter d’avoir été compris d’un seul autre homme, durant cette si courte et si longue existence. Que sera-ce de l’homme qui en vaut une infinité d’autres ? Il n’aura pas seulement l’ennui de ne pouvoir se faire comprendre. Il aura la sombre tristesse de savoir jusqu’où il n’a pas été compris. Allons plus outre : de savoir qu’il ne pouvait pas l’être. Or, cette certitude n’ôte rien à la passion de se communiquer, car elle est proprement celle d’agir, pour les esprits, et leur vie. L’homme ordinaire n’est séparé des autres que par l’étendue d’un moi ordinaire comme lui, pour ainsi dire : c’est une épaisseur de rien, un voile mince ; il peut cacher une souffrance réelle, mais elle est vite dissipée. L’autre homme est divisé de tous par un espace immense : par toutes les forces, et toutes les décisions d’une volonté presque infinie. L’Église voit l’orgueil à la base de l’hérésie ; c’est la volonté qu’il faut mettre, le nerf même de l’esprit. Que Tolstoï me touche, adolescent et même déjà avancé en âge : Bésoukhow et Lévine semblent parfois peu volontaires ; cependant, ils n’en font qu’à leur tête ; rien ne les réduit. Ils sont de cet ordre des âmes, expressément nées à la fois pour sentir, pour comprendre, et pour vouloir : mais la volonté ne leur vient qu’ensuite. Il ne leur faut qu’une foi définie : alors, ce qu’elles ont de puissance pour agir se révèle. À peine agit-il, Tolstoï se trouve plongé dans cette solitude sans fin, comme la passion d’excellence qui l’anime. Il y a tant de vérité dans son âme, qu’on ne lui fait pas un moindre tort de la méconnaître toute, que de la décomposer en vérités particulières, et d’y choisir la sienne entre mille. Ainsi, quand il est compris sur un point, il sent encore bien plus l’impuissance où il est de se faire comprendre. Qui dira la mélancolie de Tolstoï, quand on le loue d’avoir écrit les plus beaux romans du monde ? — On doit sentir dans son âme de tels dégoûts : combien peu les éprouvent ? On vante Tolstoï auteur, quand il est, et veut être apôtre ; et l’on daigne lui pardonner ses œuvres, en faveur de ses livres. En secret, comme il rougit, l’admirable vieillard, de cet éloge : Ici, il y a un homme, — et l’on veut un auteur. Pascal l’eût pris d’une autre sorte.
Voilà bien l’isolement profond, celui dont on ne peut sortir, où il faudrait amener les autres, n’y ayant point d’autre moyen de s’unir à autrui, et n’y servant de rien d’aller aux autres : Isolé par les pensées mêmes qu’on a le plus longtemps couvées, et qu’on caresse le plus, de la communion humaine. Une vue étendue du monde est un spectacle sans merci de notre propre solitude. Je pense toujours à Jésus sur sa croix, ou même à Socrate dans sa prison. Jésus peut douter de tous les hommes. Socrate peut douter de la Cité. Pourtant, Socrate a ses amis, et il sourit à la ciguë, en faisant vœu à Esculape : c’est pourquoi Socrate meurt si sereinement. Il est admirable de sagesse ; mais déjà en lui perce Épicure, si triste, selon moi, étant tout raison, et le plus résigné des hommes : mieux vaut encore une vie, qui est agonie, qu’une vie qui est la mort même. Mais vous, Jésus, pour tout ami vous avez l’éponge et le vinaigre sur la bouche, et vos lèvres sont brûlées par la dérision ; l’ironie amarifie votre soif agonisante. Il n’est point permis de vous rien comparer. Cependant, la puissante solitude suce aussi son vinaigre, et en rend sa soif plus acide. Point d’amis : car l’ami est celui qui nous comprend assez pour nous chérir, et je le trouve plus sûr que celui-là même qui nous aime assez pour nous comprendre. Nos cœurs sont de viande : ils se gâtent, ils se corrompent ; ils se déchirent aussi.
Tolstoï est donc seul, en dépit de sa gloire. Il vit retiré. Il n’a pas même conquis ceux de son sang : quelques-uns lui résistent. L’admiration l’accompagne, qui croit bon de se corroborer de blâme : car ce qu’elle admire surtout en lui, c’est qu’il lui reste incompréhensible. Les puissances de la terre honorent en lui une puissance, mais ne l’aident pas. Il avait un compagnon : il l’a perdu. Tolstoï, qui aime l’univers, est en lutte avec l’ordre universel : car il ne faut pas le vouloir à sa manière. Il n’est pas en prison, parce qu’il n’y en a pas une assez grande pour lui.
Mais il est plongé dans le profond cachot de sa condition d’homme, — au milieu du monde, et parmi cet amour de la vérité, qui est le désert infranchissable à presque tous. Qui ose y entrer ? Qui a le courage d’y poursuivre sa route ? Qui, surtout, honore assez la lumière aveuglante, et sans douceur peut être, qui baigne cet aride et sublime espace ? — Aux champs, Tolstoï parle donc volontiers à ceux de Yasnaïa Poliana, ouvriers et paysans ; il prend son plaisir avec les plus simples ; ils ont le cœur droit et fort : du moins, il est plus facile de le leur prêter et l’âme fraîche de l’enfant ; ils vénèrent la grandeur naïve ; et ils aiment comme ils admirent. Ils croient. Or, pour Tolstoï, comme pour tous ceux de son ordre, l’orgueil et la volonté sont d’être crus. On croit, grâce à ceux qui croient ; et ce, sont eux qui nous rendent sûrs enfin qu’on est digne de se faire croire.
On a toujours besoin d’affirmation. Le plus grand des hommes ne dépend pas de l’approbation d’autrui, mais son œuvre en dépend ; il ne peut se le nier. Les tyrans le savent bien, qui forcent l’assentiment. Ils y emploient des moyens à eux, qui touchent à la folie, à demi absurdes, — comme le semble toujours la violence exercée sur la pensée, — qui, par nature, lui échappe. On n’agit point dans le monde, s’il ne prend sa part de votre affirmation. C’est pourquoi la solitude, si nécessaire à l’homme de génie, finit par lui être une nécessité si terrible. Elle ruine en lui la croyance à sa propre action. Elle la réduit, en quelque sorte, à devenir négative.
Or, qu’est-ce bien qu’une action négative ? Il n’y a rien de vivant dans une négation. Il vaut mieux se tromper sur ce qu’on affirme, que nier à bon escient, — et par principe. Une grande pensée, qui n’agit pas, solitaire par contrainte, après l’avoir été par goût, faute de l’affirmation d’autrui, devient insupportable à elle-même : car il lui semble qu’elle nie. — Tolstoï a longtemps connu ce supplice ; peut-être, le connaît-il encore.
XIV
GLOIRE DE LA DOUCEUR
Vous voyez quel est cet homme, et quel héros. Quoi de plus beau que ce héros s’arrachant à lui-même, et se tournant en apôtre ? — C’est à la gloire de la douceur.
Vous avez senti sa violence ; elle ne périra qu’avec lui ; il le sait bien ; et il la tait servir à l’évangile de la doctrine la plus douce. Les grands violents sont doux. C’est ce qui les distingue des autres. Les hommes, entraînés par leurs appétits, inclinent à la violence ; et s’ils craignent de s’y livrer, s’ils n’ont pas la force de braver cette crainte, ils honorent en autrui cette violence, même s’ils la détestent, même si elle leur nuit. Car ils ont la superstition maladive de la force. Telles sont toutes les femmes, et presque tous les hommes aussi. Ils adorent dans la violence la force qu’ils n’ont pas de repousser la violence ; et s’ils l’avaient, en etiet, à leur tour ils seraient violents. Ils exaltent ainsi dans les autres l’envie de leurs propres crimes ; on les dirait presque tiers de cette force qui les décime ; et peut-être croient-ils en participer, parce qu’elle les frappe et qu’ils en sont victimes. La foule immense des violents, depuis les bourreaux jusqu’aux femmes qui les admirent, adule secrètement son désir de l’injustice, et rougit de la douceur. Combien différente par là des grands violents…
Peut-être aussi les hommes sont-ils plus doux en Orient qu’ailleurs, et plus paisibles. Ils ont beaucoup soulfert, et depuis plus de temps. Ils sont encore prêts à subir toute sorte de tortures. La même force les soutient dans les supplices, et dans l’amour de ceux qui les y arrachent. Là-bas, ni l’innocence ni la douceur ne sont tout à fait un objet de mépris. Mais on y voit des clartés divines.
Tous les prophètes ont été violents par douceur, et jusqu’à la mort. Dans son transport le plus sublime, Jésus garde le silence. Il ne répond à toute la force de l’univers, à Rome, à la mort, aux Juifs, à l’abandon de ses amis, aux soufflets, à la croix, à la moquerie même et aux épines, que par le mot unique d’une douceur unique : « Tu l’as dit. »
La douceur est un don de soi à la beauté du monde. Elle triomphe comme on s’humilie. On le fait beau, on l’aime divin, ce monde, — pour qu’il le soit. Humihation incomparable, où tout l’être s’incline par amour.
La douceur naît dans le cœur des grands violents par une vue de la vanité de toutes choses. En ce peu, qu’est-ce que le plus ? ou la victoire ? ou l’empire ? — Le grand homme n’arrive point au terme de son œuvre, sans un amer sourire. Car il ne touche point au terme de son désir. Un dégoût, profond comme le repentir, voilà sa borne. Il a besoin d’être pardonné. Il cherche le pardon d’avoir été grand. Car, s’il l’a vraiment été, il sait ce que cette grandeur coûte. Ce comble de rien.
⁂
« Quelle œuvre vaut les larmes qu’elle a fait couler ? Quel bienfait peut s’égaler à celui d’avoir séché ces larmes, après celui de les avoir épargnées ? Quelle grandeur approche la bonté, dont la caresse chaste arrête la plainte sur les lèvres, et retient sur les yeux les pleurs qu’ils allaient répandre ?
« L’innocence seule peut connaître le bonheur ; car elle ignore le mal. Voilà des enfants rieurs, comme l’herbe au soleil ; et leur vue passe toute science.
« Ma grandeur, dit ce héros, ira jusqu’aux étoiles ; mais elle n’ira pas jusqu’au bonheur. Je verrai Dieu, peut-être ; mais, comme Moïse a vu les jardins de Chanaan : — du sein de sa propre mort, et sans mettre le pied sur la terre promise. Je serai grand. Et toujours triste.
« Mais la créature innocente vivra dans le cœur de Dieu, sans peine, et en riant. Toutes les bénédictions sont pour les doux. C’est à eux que vont les béatitudes. Heureux les pacifiques, est-il dit : la paix est douce. Heureux les pauvres d’esprit : ils ont la douceur, étant sans vanité. Heureux les affligés : s’il souffrent, c’est qu’ils sont doux. Heureux les débonnaires : la douceur est en eux, au lieu de l’intérêt. Heureux les miséricordieux : le pardon est doux. Heureux les affamés du juste ; heureux les persécutés pour la justice ; heureux les purs : toute leur force vient de leur douceur ; heureux donc seuls les doux. »
⁂
Ainsi les grands violents, sans cesser de l’être, mettent toute leur violence, à la fin, dans l’admiration et l’amour des âmes douces. Une étrange envie, qui n’ose s’en croire elle-même, s’y mêle encore : ils chérissent dans la douceur la perte infinie qu’ils ont faite, — l’innocence et la joie de la vie.
Comme ils aiment, ces simples créatures, qui ont vécu sans se voir vivre ! Qui sont nées, ont crû, et se sont évanouies à leur jour dans la prairie de Dieu, comme les plus humbles herbes du pré, qui ne sont pas les moins vertes, ni les moins joyeuses. Ils jettent un regard passionné sur tous ces êtres qui sont passés en faisant le bien, — Transivit nulli faciendo : car, ne faire que le bien, c’est n’avoir rien fait, selon l’honneur du monde. La plupart des hommes ne connaît la vie que par l’abus qu’ils en font sur les autres, ou celui que la vie des autres fait d’eux.
Il n’y a point de mère que le rire d’un entant pénètre comme il fait le cœur de cet homme, où il ressuscite un monde, dont l’innocence fait le délice. La plus pure des choses, et la plus heureuse, est celle qui connaît le moins sa pureté et son bonheur. Cette grande âme est donc pleine de tristesse : elle enseigne une joie, qu’elle sait comme personne, et qu’elle ne peut plus goûter à l’égal de la connaître. Et, sans doute, le plus grand des hommes se surprend à sentir le remords de sa grandeur.
Voilà Tolstoï, et la douceur où il met toute la gloire.
XV
QUE L’ART S’IMPOSE À
LA SAINTETÉ MÊME ET DOMINE TOUTE VIE
Laissons le soleil préférer une récolte à l’autre, dans le champ qu’il féconde : c’est la moisson tout entière qui importe à ceux qu’elle nourrit. En son effet, l’œuvre du génie échappe à celui qui la crée. Tolstoï qui renie ses poèmes, et Tolstoï qui les a produits, ne seront bientôt qu’un seul homme pour son peuple : il se reconnaîtra, ici et là, en lui seul. Cette vie magnifique est née du sein de l’action ; son art est comme elle, et l’imite. Elle est harmonieuse, avec cette majesté immense et pleine, où la vie seule peut prétendre. Elle se déroule, variée en ses aspects, unique en son cours, grossie insensiblement d’elle-même, comme un fleuve puissant, dont la pensée peut distinguer les ondes, mais ne les sépare point. Il n’est pas moins ce qu’il doit être à sa source, qu’en son delta d’épais limon, où il s’attarde, avant de finir par mille bouches, riches en villes et en maisons pour le séjour des hommes. À la manière d’un temple, ou d’un drame parfait, cette vie admirable s’embrasse d’un seul regard, où tous les détails et toutes les proportions s’équilibrent dans un calcul unique. Qu’une telle vie adopte ou répudie l’Art, elle en est elle-même un chef-d’œuvre ; et sa candeur apparente n’est qu’une grâce de plus, où l’Artiste divin a mis sa marque. La pensée, que n’entrave plus le lien des apparences, retrouve la même vérité, où l’illusion de l’univers est suspendue : tel un pendule oscille d’un bord du rêve à l’autre bord : et ce point fixe est, qu’en toute chose, qui compte pour l’homme, — dans la grandeur de la volonté, dans la force du fait, dans le sacrifice des saints, — toujours l’Art préside à son œuvre, et la contemple.
Les plus beaux monuments de l’art, comme les plus belles vies, ne se font pas toujours en vue de l’art même. Ici, l’on peut voir un rapport admirable de l’art avec l’action. Ces chefs-d’œuvre de l’art ne sont qu’un résultat de l’action. Tolstoï n’a, pour ainsi dire, écrit qu’au soir des journées qu’il a dû vivre. Ses poèmes sont la réflexion de sa vie. Il était fatal, en son pays et en son temps, qu’il passât du livre à la nature, et qu’il finit par la charité. Le peuple russe cherche continuellement Dieu.
Les hommes de l’Occident, las d’agir ou sans force, se font des théories de l’action, pour en distraire un vague désir. Ils en ont d’incertaines, et de singulières, où l’on sent l’impuissance des gens de lettres, et la décrépitude où mène la littérature. Pour la plupart, ils opposent la pensée et l’action. Ils finissent par ne plus entendre l’action que sous l’espèce brute, la plus matérielle. Il leur semble qu’un homme d’action soit celui qui donne des coups de poing par métier ; à tout le moins, celui qui fait le tour du monde, ou traverse l’Afrique. Qui les en croirait, ne serait pas loin de croire que Descartes, rédigeant la méthode, n’est pas homme d’action. Enfin, l’action, comme ils la prônent, n’est qu’une opinion littéraire. Comme la mode en vient, elle en peut passer. J’imagine que ces esprits énervés, dans leur inquiétude de ne point agir comme il faut par la pensée, confessent surtout la vanité de leur littérature. Et, il est vrai, que ce qu’ils écrivent, n’importe en rien ; mais il n’importerait pas davantage qu’ils fussent planteurs paresseux sous les tropiques, ou acrobates. Ils ne sont pas raisonnables, là-dessus, de s’en prendre à Descartes. L’action n’est point dans les formes de l’acte : elle dépend de la force de l’âme. Que les âmes soient capables d’agir, — voilà le point.
Où le mieux voir qu’en Tolstoï ? — Art, foi, ou religion ; peintures de la guerre et de la paix ; œuvres didactiques ou apostolat parmi les paysans en proie à la famine, — c’est toujours la même force qui agit. C’est toute celle d’un peuple. Toute la vie de la Russie est dans cette âme. Elle doute de soi ; elle cherche Dieu ; elle le découvre, et s’y consacre. Les états diffèrent, et c’est tout. L’action reste la même : Tolstoï a révélé la Russie à la Russie. Comme elle, à la poursuite du pain de vie, il est allé quérir, sans pouvoir le rencontrer, ce grain inestimable sur l’aire, où les autres races ont battu leur blé, — et il ne l’a trouvé qu’en rentrant en soi.
Il précède le peuple russe, dont l’action se déroulera, dans l’avenir, selon les époques de la sienne. On entend dire, parfois, que Tolstoï n’a pas de style. Un étranger ne s’en fait pas juge. Selon l’opinion des critiques, il n’a pas le style savant comme Gontcharow, ou raffiné comme Tourguéneff. Il se peut que Tolstoï n’ait pas de style, si l’on entend la manière d’un auteur. Mais je gage qu’il a celui où la Russie verra plus tard le type de l’expression russe. On ne saurait définir le style d’Homère : il échappe à la rhétorique ; on sent toutefois que l’Odyssée et l’Iliade enferment tout le génie de la race. Tolstoï a laissé les épopées d’une nation inquiète, curieuse d’analyse et de vérité, héroïque dans le combat moral.
La théogonie d’Homère ne répondait plus à rien, qu’Homère était toujours le père nourricier de la vie grecque. Tel est le miracle de l’art, où une action éternelle a pris sa forme. Quand nul ne se souciera si Tolstoï a traduit bien ou mal les mots de l’Évangile, sa pensée, son sentiment, sa morale, ne cesseront point de vivre dans l’âme de son peuple et d’y fructifier. Son art et sa religion se seront confondus dans l’amour de ce peuple, comme le témoignage le plus complet qu’il ait reçu du divin, qui lui soit propre. Une nation ne produit qu’une fois l’homme, où elle prend conscience de son génie. L’honorât-elle du nom d’un Dieu, il faut toujours y voir un artiste.
C’est un tel homme, qui aura vécu sous nos yeux, — ce Tolstoï, l’Homère du monde slave.
Août 1898.
1 Il n’est question, on l’a compris, que des contemporains, — de Wagner et d’Ibsen, pour les appeler par leurs noms.
2 Les plus caractéristiques sont : 1° Celui de 1856. où il est dans une compagnie d’auteurs, parmi lesquels Tourguénew, Ostrowsky, et Gontcharow. Tolstoï est debout, en uniforme, le visage rasé. C’est le seul portrait de sa jeunesse, où il retienne l’attention. La figure n’est pas belle ; mais un air sombre, en partie voulu, et comme décidé à n’être point confondu avec les autres. Derrière eux, il semble plutôt garder ces gens de lettres que faire partie de leur société : on le dirait prêt à les reconduire en prison. 2° Un portrait de 1872, avec toute la barbe. Aucune recherche, ou si quelqu’une, celle du contraire de l’élégance. La barbe épaisse couvre le visage jusqu’aux yeux. Les cheveux, coupés ras, font paraître le front plus sec et plus réduit qu’il n’est. Les yeux et la bouche ont une expression brutale. Voilà l’image d’un homme mécontent de tout, et de lui-même. Pourtant, le regard semble déjà passer au delà de l’objet présent. 3° Un portrait de Moscou, vers 1885, quand Tolstoï vient de découvrir la vérité et la vie. Il règne sur cette figure un calme, une douceur sérieuse, une tristesse admirable. La barbe longue n’est plus hirsute. Les yeux ont la paix ; ils fixent sans âpreté ce qu’ils voient ; ils ne s’attachent pas avec trop de passion au but qu’ils se proposent. Ce sont les fiançailles de Tolstoï avec la vie nouvelle. Il ne lui reste de l’ancien homme que les cheveux, moins courts déjà, mais trop abondants encore, partagés, d’une manière désagréable, en deux bandeaux coiffés avec soin, sur le milieu de la tête. 4° Le dessin de Répine, de 1888, si connu : Tolstoï fauchant, une casquette sur le front, la barbe longue, balayée en épi par le vent, le corps vêtu d’une blouse russe, serrée à la taille, les jambes chaussées de grandes bottes. Ce croquis est plein de vie et de force. 5° Enfin, les deux portraits de 1894-1895 : Tolstoï à mi-corps, tête nue, chauve sur le haut du front, les cheveux assez longs tombant par derrière sur les oreilles.
3 Bésoukhow, Nékhlioudow, Lévine ne peuvent s’empêcher de rougir à tout propos ; cette rougeur fait leur supplice. Image de leur disparité avec le monde : ils sont hors de lieu, elle sentant. On rougit, on pâlit, ou l’on se tait, selon les tempéraments.
 La Revue des Ressources
La Revue des Ressources