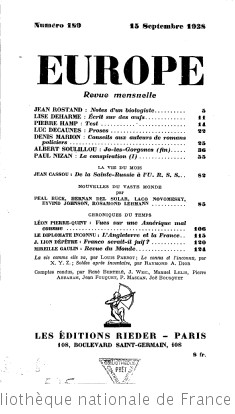
Europe (Paris. 1923)
Source : Bibliothèque nationale de France
I
En somme dit Rosenthal, cette revue pourrait s’appeler La Guerre Civile…
— Pourquoi non ? dit Laforgue. Ce n’est pas un mauvais titre, et il dit bien ce que nous voulons dire. Tu es sûr qu’il n’est pas pris ?
— La guerre civile est une idée qui doit être dans le domaine public, dit Rosenthal. Ça ne se dépose pas.
C’était un soir de juillet, à cette heure après chien et loup où la sueur s’évapore sur la peau et où toute la poussière du jour achève de retomber comme les cendres d’un incendie perdu ; un assez vaste ciel s’étendait au-dessus du jardin, qui n’était qu’un petit enclos d’arbres grillés et d’herbe malade, mais qui faisait tout de même éprouver au cœur des collines de pierre de Paris le même genre de plaisir qu’une prairie.
Dans les appartements de la rue Claude-Bernard que Laforgue et ses amis épiaient parfois pendant des heures comme s’ils avaient abrité des secrets importants, les gens commençaient à se préparer à la nuit ; on voyait vaguement passer devant une lampe une épaule ou un bras nu : des femmes se déshabillaient, mais elles étaient trop loin pour qu’on pût distinguer si elles étaient vraiment belles ; elles ne l’étaient pas. C’étaient plutôt des dames entre deux âges qui enlevaient des corsets, des ceintures et des gaines comme des pièces d’armure ; les plus jeunes habitantes de ces maisons, celles dont les chansons jaillissaient parfois du fond d’une cuisine, couchaient sous les combles : on ne les voyait pas.
Des airs de musique, des discours, des leçons, des réclames sortaient de la gueule des haut-parleurs dans un rabâchage confus ; de temps en temps, un autobus grinçait à l’arrêt de la rue des Feuillantines ; il y avait pourtant des moments où une espèce de grand silence marin déferlait paresseusement sur les récifs de la ville.
Rosenthal parlait. Il parlait toujours beaucoup parce qu’il avait une voix prophétique et qu’il pensait persuader facilement à cause du timbre de sa voix ; ses compagnons l’écoutaient en regardant les reflets framboise de Paris au-dessus de leurs têtes, mais ils songeaient confusément aux femmes qui se couchaient et qui disaient à leurs maris, à leurs amants des mots de machines parlantes ou peut-être des phrases bouleversantes de haine, de passion ou d’obscénité.
C’étaient cinq jeunes gens qui avaient tous le mauvais âge, entre vingt et vingt-quatre ans ; l’avenir qui les attendait était brouillé comme un désert plein de mirages, de pièges et de vastes solitudes. Ce soir-là, ils n’y pensaient guère, ils espéraient seulement l’arrivée des grandes vacances et la fin des examens.
— À la rentrée, dit Laforgue, nous pourrons donc publier cette revue, puisqu’il se trouve des philanthropes assez naïfs pour nous confier des argents qu’ils ne reverront pas. Nous la publierons, et au bout d’un certain temps, elle mourra…
— Bien sûr, dit Rosenthal. Est-ce que l’un de vous est assez corrompu pour croire que nous travaillons pour l’éternité ?
— Les revues meurent toujours, dit Bloyé. C’est une donnée immédiate de l’expérience.
— Si je savais, reprit Rosenthal, qu’une seule de mes entreprises doive m’engager pour la vie jet et me suivre comme une espèce de boulet ou de chien fidèle, j’aimerais mieux me foutre à l’eau. Savoir ce qu’on sera, c’est vivre comme les morts. Vous nous voyez, dans des quarante ans, dirigeant une vieille Guerre civile, avec les sales gueules de vieillards que nous aurons, façon Xavier Léon et Revue de Métaphysique !… Une belle vie, ce serait une vie où les architectes construiraient des maisons pour le plaisir de les abattre, où les écrivains n’écriraient des livres que pour les brûler.
Il faudrait être assez pur, ou assez brave, pour ne pas exiger que les choses durent…
— Il faudrait, dit Laforgue, être absolument délivré de la peur de mourir.
— Pas de romantisme, dit Bloyé, ni d’angoisse métaphysique. Nous faisons des projets de revue et nous avons des conversations élevées parce que nous n’avons ni femmes ni argent ; il n’y a pas de quoi s’exciter. D’autre part, il faut faire des choses, et on les fait. Ce ne sera pas toujours des revues.
— Si on allait boire, dit Pluvinage.
— Allons, dit Jurien.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Les Rosenthal habitaient avenue Mozart, à une époque où presque tous leurs parents, leurs amis restaient encore fidèles à la plaine Monceau et envoyaient leurs fils au Lycée Carnot ou au Lycée Condorcet et leurs filles au cours Dieterlen, où le grand déplacement vers Passy et Auteuil n’avait pas encore pris l’ampleur singulière qu’il devait prendre dans les années suivantes.
On suivait d’abord un grand couloir de pierre blanche coupée par de longues glaces et de sanglantes banquettes de velours grenat et on arrivait au rez-de-chaussée des Rosenthal. C’était un grand appartement qui donnait par des portes-fenêtres sur un jardin humide entouré de grilles et obscurci par de hauts immeubles blancs. Le grand et le petit salon étaient envahis de statues, de livres reliés, de tableaux sombres et de consoles à pieds dorés ; il y avait un piano à queue, un gros saurien luisant protégé par un châle de Séville, une harpe, des toiles de Fantin-Latour et de Dagnan-Bouveret, qui dataient de ce temps où les peintres avaient tout à gagner à adopter de doubles noms qui leur conféraient une noblesse roturière.
M. Rosenthal était agent de change : on se serait cru chez un grand chirurgien, et les jours où Mme Rosenthal recevait, toutes ses invitées paraissaient attendre l’heure d’un rendez-vous et un verdict sur l’état de leur appendice ou de leurs ovaires : le moment n’était pas encore venu de livrer ces appartements meublés vingt ans plus tôt avec un amour égaré aux décorateurs de mil neuf cent vingt-cinq ; seuls les jeunes ménages commençaient à s’installer dans des pièces blanches meublées de verre et de métal : on ne sortait pas de la médecine.
Bernard entra chez lui. Dans cet appartement solennel, sa chambre n’avait que l’ambition d’être austère : elle était meublée d’une grande table, d’un lit de cuivre que Bernard avait jugé moins frivole qu’un divan, et d’une armoire anglaise ; il y avait au mur des rayons dont les livres étaient moins reliés que ceux du grand salon, une mauvaise lithographie de Lénine, une assez bonne reproduction du Descartes de Hais et un petit paysage métaphysique de Chirico, qui rappelait assez bien les réserves d’un musée provincial sous une lune de théâtre et qui date l’époque où se déroule cette histoire de jeunes gens. Bernard prit un bain et se coucha, pensa qu’il avait décidément trop fumé et qu’il avait un peu faim ; il songea ensuite vaguement à la révolution, et précisément à sa famille, aux meubles du grand salon, à la cuisine où il devait rester des choses dans le frigidaire. Il se dit qu’il fallait en finir, sans bien savoir s’il s’agissait de couvrir Paris de barricades, de prendre le lendemain un train qui l’éloignerait pour quelques semaines de son père et de sa mère, de son frère, de sa belle-sœur, des domestiques, ou simplement de descendre à la cuisine, il avait vraiment trop sommeil, il s’endormit enfin.
Un quart d’heure après Rosenthal, Pluvinage avait quitté à son tour le Canon des Gobeloins. Pluvinage, qui préparait l’agrégation de philosophie à la Sorbonne, habitait seul une chambre assez sinistre dans un hôtel de la rue Cujas, où vivaient des étudiants chinois, des filles du Pascal, du d’Harcourt et du Soufflet. Comme toujours, ses compagnons se sentirent légèrement soulagés par son départ, mais comme ils estimaient que c’était un sentiment assez bas, ils n’en parlèrent pas. Laforgue, Bloyé et Jurien retardèrent comme ils pouvaient le moment d’aller dormir. Heureusement, ils aimaient passionnément Paris, leur quartier et les promenades de nuit.
Dans la rue Mouffetard, ce soir-là, traînaient des odeurs de viande morte, de chat et d’urine et les invisibles flocons de la misère ; comme toujours, dans ces déserts endormis de Paris, Laforgue et ses camarades ne virent s’esquiver que les derniers rôdeurs de la malchance, ces vieilles femmes qui roulent de portail en portail avec des cabas pleins de papiers, de croûtes, de chiffons et de ces détritus brillants de fer, d’os, de nacré et de faïence que les maniaques des asiles cousent sur leurs gros jupons, ces noirs et ces manœuvres algériens qu’on entend chanter si tard en été sous les arbres de papier vert de la place Maubert comme sur un toit d’Afrique ; comme toujours, ils n’avaient plus qu’à se résoudre à aller dormir en se disant que ce n’était quand même pas une vie et ils rentrèrent ; ils avaient beau crocheter rêveusement dans le petit tas de débris de la journée, ils n’en ramenaient pas grand’chose : il ne s’était rien passé.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
II
Le surlendemain, Rosenthal vint retrouver ses amis.
Toutes ces rencontres ont lieu à l’École Normale, rue d’Ulm.. C’est un grand édifice carré du temps de Louis-Philippe ; une cour en fait le centre, avec un bassin de ciment où des, poissons rouges tournent paresseusement ; entre les fenêtres court pour l’exemple une guirlande ; de grands hommes ; une froide odeur de soupe conventuelle traîne le long des couloirs ; vitrés ; un homme nu qui meurt contre un mur, en tendant un flambeau de pierre que personne n’a envie de lui prendre des mains, symbolise les Morts de la guerre ; en bordure de la rue Rataud s’étend un tennis, et entre la rue Rataud et la rue d’Ulm, un jardin orné d’un banc de pierre sculptée et de deux femmes nues d’un contour assez mou souvent décorées d’inscriptions obscènes. À l’une des extrémités du tennis s’élève un petit laboratoire de physique dans le style des baraques historiques où des inventeurs célèbres ont découvert le moteur à explosion ou le détecteur de sans fil ; à l’autre extrémité se dressaient il y a dix ans un gymnase, et des laboratoires de biologie végétale, qui tombaient en ruines autour d’un petit potager botanique qu’on appelait la Nature.
Du haut des toits, on découvre avec le sentiment d’exaltation et de pouvoir qu’inspirent les altitudes toute la moitié sud de Paris et son horizon voilé, hérissé de dômes, de clochers, de nuages et de cheminées. C’est sur ces toits que Laforgue, Rosenthal, Bloyé, Jurien et Pluvinage parlèrent encore de la Guerre civile, sans s’exagérer la portée qu’elle pourrait avoir, mais en pensant cependant qu’elle ferait peut-être partie des mille petites entreprises par quoi finalement on croit que change le monde.
On était à la fin du mois de juin mil neuf cent vingt-huit. Comme ces jeunes gens vivaient dans un pays qui en vaut bien un autre, mais où le président du Conseil expliquait justement alors à la tribune de la Chambre qu’il n’était pas mécontent d’avoir été nommé par les communistes Poincaré-la-Guerre et Poincaré-la-Ruhr –– parce que s’il n’avait pas visité les premières lignes de la guerre avec ses molletières et sa petite casquette de chauffeur et s’il n’était pas entré sur l’autre rive du Rhin, où en serait la France ? –– et comme ils n’étaient pas pressés par la nécessité déprimante de gagner leur pain sur le champ, ils se disaient qu’il fallait changer le monde. Ils ne savaient pas encore comme c’est lourd et mou le monde, comme il ressemble peu à un mur qu’on flanque par terre pour en monter un autre beaucoup plus beau, mais plutôt à un amas sans queue ni tête de gélatine, à une espèce de grande méduse avec des organes bien cachés.
On ne peut pas dire qu’ils soient absolument dupes de leurs discours sur la métamorphose du monde : les gestes qu’entraînent leurs phrases leur paraissent simplement les premiers effets d’un devoir dont l’accomplissement comportera plus tard des formes d’un tout autre rendement, mais ils se sentent révolutionnaires, ils pensent que la seule noblesse réside dans la volonté de subversion. C’est entre eux un dénominateur commun, bien qu’ils soient sans doute destinés à devenir des étrangers ou des ennemis. Spinoza, Hegel, le marxisme, Lénine ne sont encore que de grands prétextes, de grandes références embrouillées, et comme ils ignorent tout de la vie que mènent les hommes entre leur travail et leur femme, leurs patrons et leurs enfants, leur petites manies et leurs grands malheurs, il n’y a encore au fond de leur politique que des métaphores et des cris…
Peut-être Rosenthal est-il simplement promis à la littérature et ne construit-il que par provision des philosophies politiques ; Laforgue et Bloyé sont encore trop près de leurs arrière-grands-pères paysans pour se livrer sans beaucoup d’arrière-pensées et de restrictions mentales à de sérieuses manifestations mystiques ; Jurien se laisse aller à suivre des camarades singulièrement différents de lui-même : il a le sentiment qu’il jette sa gourme, comme dit son père qui est un instituteur radical dans un petit bourg jurassien, et que la Révolution est moins dangereuse pour la santé que les femmes : il est vrai qu’elle donne d’abord moins de plaisirs, elle ne l’empêche pas de faire de mauvais rêves ; Pluvinage est peut-être le seul d’entre eux qui adhère pleinement à son action, mais c’est une adhésion qui ne peut que mal finir, parce qu’il ne se soucie au fond que de vengeance et croit à son destin sans retour d’ironie sur lui-même.
Tout cela est terriblement provisoire et ils le sentent bien. C’est à vingt ans qu’on est sage : on sait alors que rien n’engage ni ne lie, et qu’aucune maxime n’est plus basse que la fameuse phrase sur les pensées de jeunesse réalisées dans l’âge mûr ; on ne consent à s’engager que parce qu’on devine que l’engagement ne donnera pas une figure définitive à la vie ; tout est confus et libre ; on ne fait que de faux mariages, à la mode des coloniaux qui attendent les grandes orgues nuptiales des métropoles. La seule liberté enviable paraît celle de ne point choisir : le choix d’une carrière, d’une femme, d’un parti n’est qu’une défaillance tragique. Un camarade de Laforgue venait de se marier à vingt ans ; ils parlaient de lui comme d’un mort, au passé.
Ils n’eussent pour rien au monde avoué ces certitudes ; sa sagesse n’empêche pas le jeune homme de mentir. Il avait fallu l’avant-veille une heure de paresse sur l’herbe, les tentations et l’inimitable ton de confidences de la nuit pour que Rosenthal se laissât aller à parler tout haut de maisons détruites et de livres brûlés ; ils traitaient leurs improvisations comme des décisions pour la vie, car ils accompagnaient encore leurs actes d’illusions qui ne les trompaient pas ; Ils ne se laissaient même pas égarer sur le sens de leur amitié, qui n’était qu’une complicité assez forte d’adolescents trop menacés pour ne pas éprouver le prix des liens d’équipe, trop solitaires pour ne pas s’efforcer de remplacer la réalité des compagnes nocturnes, par les reflets de la camaraderie virile : fonder l’avenir sur des connivences de jeunesse paraissait à chacun d’eux, le comble de la lâcheté.
Sur la couverture de la revue, dont ils établirent la maquette ce jour-là, étendus sur le métal brûlant des combles et la tête bourdonnante de soleil, ils décidèrent de faire graver une mitrailleuse ; ce fut Pluvinage qui la leur proposa.
L’année finissait. Rosenthal voulait que tout fût prêt pour le mois de novembre ; il mettait à ce dessein la même impatience qui pouvait parfois l’entraîner à la poursuite d’une femme. Tout ce que Bernard entreprenait devait s’exécuter à une allure si vive qu’il semblait qu’il n’eût que peu de temps à vivre, qu’il se préparât une mort pleine de regrets, de souvenirs, de projets. Ses amis n’osaient lui résister : ces impatients jouent quelquefois les rôles de chefs. D’ailleurs, c’était Rosenthal qui avait trouvé les fonds de la revue : ces vingt-cinq mille francs, cette habileté dans le siècle lui donnaient le droit et les moyens de convaincre des jeunes gens qui n’étaient pas encore sortis de leurs études et de la claustration du lycée, et aux yeux de qui l’argent paraissait absolument magique.
III
Rue d’Ulm, on traversait cette époque incertaine où, les examens achevés, on en attend les résultats dans un extrême désœuvrement qui a bien des charmes pour des adolescents naturellement paresseux, mais, contraints pendant des années à d’absurdes travaux.
Laforgue passait des après-midi entières sur un divan tendu d’une étoffé dorée qui était devenue fort sombre ; il prenait, un livre et commençait à lire, mais il s’endormait bientôt ; quand il avait trop chaud, il descendait au rez-de-chaussée et allait prendre une douche, ou un verre dans un bistrot de la rue Claude-Bernard.
Une après-midi, vers quatre heures, quelqu’un frappa, c’était Pauline B…, une jeune fille qui n’était plus tellement jeune et qui venait de temps en temps voir Laforgue, rue d’Ulm, quand elle avait envie d’être embrassée. Laforgue l’avait rencontrée sur une petite plage en Bretagne où les jeunes gens embrassaient les jeunes filles après des allées et venues sur la digue, quand elles s’étaient étendues sur le sable et qu’elles étaient désarmées par la nuit, les étoiles, ou la phosphorescence verte de la mer qui venait grésiller à leurs pieds. Philippe avait toujours beaucoup de peine à soutenir la conversation avec Pauline ; il se disait qu’il n’avait jamais détesté une femme comme elle, mais il n’avait pas tant d’occasions de caresser une poitrine et des jambes et il s’arrangeait. Il lui disait grossièrement :
— Vous connaissez des gens impossibles, le curé de la Madeleine, le gouverneur militaire de Paris. Dire que vous êtes la nièce d’un préfet de police ! Qu’est-ce que vous venez faire chez moi ?
Pauline l’avait conduit un jour à une vente de charité dans l’Hôtel des Invalides ; sur le boulevard, c’était le printemps, des invalides assis dans leurs pétites voitures lisaient leurs journaux au soleil ; le général Gourand promenait sa manche vide parmi les dames de l’Union des femmes de France ; ces anciennes infirmières averties de cette illusion des amputés qui ne fait pas moins parler d’elle que la bille d’Aristote et les vieilles plaisanteries des opticiens, s’effaçaient pour ne pas heurter la manche vide, ce bras d’ombre : s’imagine-t-on le général s’abandonnant soudain, lâchant le cri de douleur qu’il avait retenu jusqu’au bout sur les champs de bataille ? On vendait des objets que personne n’avait envie d’acheter — c’est toujours la même chose dans les ventes, heureusement qu’il faut bien des cadeaux pour les bonnes, les parente pauvres — des coussins, des paillassons, des brosses, des ustensiles fabriqués par des aveugles de guerre et tristes comme leurs chiens, ou par des pupilles jaunes et noires des religieuses françaises de l’Anamm et de la Côte des Somalis. Pauline rappelait toujours à Laforgue le temps de guerre, où en province, il allait le jeudi à l’hôpital du couvent Sainte-Madeleine voir les blessés fabriquer du macramé et tricoter des cache-nez, les sœurs courir, ces saintes filles qui n’avaient jamais été à pareille fête, où, le dimanche soir, lorsqu’il avait servi le Salut en faisant tinter les sonnettes devant les soldats qui somnolaient et songeaient qu’ils étaient aussi bien là qu’ailleurs, les convalescents lui donnaient des cigarettes qui le faisaient vomir ; en revenant dans un taxi où Pauline l’embrassait, il se disait qu’elle n’était acceptable que comme un souvenir d’enfance, le reflet des infirmières à voile bleu avec leurs seins si beaux sous les empiècements carrés et sous la médaille palpitante des épidémies.
Pauline se mit à parler des concours du Conservatoire et de l’exposition des envois de Rome ; elle n’avait jamais grand’chose à faire, elle ne manquait pas un concert, une exposition, une grande vente, elle allait un jour par semaine dans une consultation conseiller les jeunes mères sur l’allaitement des nouveaux-nés et les maladies du premier âge ; elle avait peu d’argent ; elle ne se mariait pas.
Laforgue affectait de ne jamais mettre les pieds dans une galerie de peinture, chez un marchand de tableaux, à l’Opéra, salle Pleyel : c’était assez leur genre ; comme ses amis, il criait avec orgueil sur les toits qu’il se moquait de la peinture, de la musique et du théâtre, et qu’il préférait les bistrots, les foires du Lion de Belfort, les cinémas de quartier et les kermesses de l’avenue des Gobelins. C’était une sorte de défi qu’ils lançaient aux gens à qui les beaux-arts servaient de mérite, de justification, d’alibi. Comme il connaissait assez bien l’Espagne et l’Italie, Philippe aurait pu parler tout de même de la peinture, mais Pauline ne venait pas rue d’Ulm pour causer sérieusement de tableaux ou de musique et Laforgue jugeait qu’il n’y avait pas lieu de se donner la peine d’être poli. Il s’assit près de Pauline sur le divan et elle lui dit qu’il n’était pas bavard.
— Excusez-moi, Pauline, dit-il. Dieu sait pourtant qu’il s’en passe ! 30 degrés à l’ombre à Perpignan, un anticyclone de derrière les Sargasses marche sur les Açores. Le financier Loewenstein s’est noyé dans la Manche et la Bourse d’Amsterdam est considérablement émue. On joue Maya au théâtre de l’Avenue, où nous n’irons pas. Il y a eu quarante-huit morts à Roche-la-Molière, mais comme ce sont des mineurs, cet incident n’a pas une importance démesurée et M. Tardieu s’est entretenu familièrement avec les blessés, ce qui arrange bien des choses, À Paris…
— Embrassez-moi plutôt, dit Pauline.
Philippe l’embrassa et il trouva à ce geste un plaisir légèrement irrité parce que la sueur de l’été salait un peu les lèvres de Pauline, que son rouge avait un drôle de goût, et qu’elle était une de ces femmes impossibles qui mettent en scène toutes leurs émotions, tremblent quand on touche leurs seins et qui organiseront sur le tard des crises de nerf parfaitement imitées.
— Que de manières ! pensait Laforgue. De quoi aurais-je l’air si Bloyé rentrait, avec cette fille théâtrale, sa figure de transe ? Il vaudrait peut-être mieux que j’aille boucler la porte.
Il s’éloigna de Pauline pour aller pousser le verrou.
— Est-ce que vous auriez de mauvaises intentions ? demanda-t-elle avec un petit rire arrangé. Je ferais probablement mieux d’enlever ma robe.
— Je le crois aussi, dit Laforgue.
Pauline se leva et enleva sa robe, une robe couleur de feuille morte qui faisait justement un sec petit bruissement de feuille morte ; elle portait une combinaison mauve avec de grandes bandes de dentelle ocrée qui lui coupaient la poitrine et les jambes.
— Cette femme n’a aucun goût, se dit Philippe, qui n’aimait chez les femmes qu’une lingerie pure ou les artifices extravagants des grues de la Madeleine et de l’Opéra.
Elle avait des épaules et un torse un peu grêles mais des jambes et des hanches assez lourdes pour lesquelles Philippe avait assez de goût pour lui pardonner son linge. Elle s’allongea sur le divan et étendit sa robe sur ses genoux ; Laforgue, couché le long de ce corps moite, pensait qu’il aurait bien dû tirer le rideau avec tout ce soleil qu’ils avaient en plein dans les yeux et qui illuminait les taches de rousseur sur la peau blanche de Pauline au-dessus du grand ourlet de ses bas, mais il commençait à ronronner et il n’eut pas le courage de se lever. Pauline n’était pas une femme avec qui il fût question de coucher ; elle se défendait avec une présence d’esprit obstinée qui n’entravait guère sa poursuite du plaisir. Elle ferma les yeux ; le fard disparut de ses joues ; le mouvement de son ventre faisait penser au battement saccadé et rêveur de l’abdomen d’un insecte ; elle était solitaire, absolument enfermée en elle-même, dans l’application étrange du plaisir ; son cœur battait durement dans tout ce profond travail ; Laforgue se rappelait qu’il ne s’était pas rasé le matin, et que Pauline aurait des points rouges autour de la bouche et des plaques roses au creux de l’épaule, mais comme il pensait à cette étrangère avec rancune, il se disait que c’était bien fait. Ces caresses, ces mouvements, ces respirations coupées faisaient une torpeur taciturne et mouvante, une précipitation aveugle, une maussaderie dont on ne voyait pas la fin. Pauline serra soudain les dents, rouvrit les yeux, et Laforgue épia avec rage cet air d’égarement, cette angoisse de coureur au bout de son effort ; le corps de la jeune fille se tendit, ses cuisses se serrèrent avec une force incroyable sur le poignet de Laforgue qui atteignit lui-même un plaisir incertain.
Pauline s’abandonna, posa une main sur son sein :
— Nous sommes insensés, soupira-t-elle.
Elle s’étira, elle referma les yeux. Plus tard, elle se souleva sur un coude et prit une glace dans son sac, se regarda :
— Comme je suis faite ! s’écria-t-elle.
— Défaite, dit Philippe.
Elle était échevelée, une rosée de sueur perlait encore sur ses tempes, aux ailes de son nez, à la racine de ses cheveux, après le dur engendrement du plaisir. Laforgue regardait ces lèvres blanches :
— L’amour n’arrange pas les femmes, se dit-il.
— Essuyez votre bouche, dit Pauline. Si vos amis voyaient tout ce rouge…
Elle couvrit ses seins, qui étaient attachés un peu bas et elle se leva pour passer sa robe. Pauline réussissait avec une promptitude admirable le passage difficile des désordres du plaisir à la vie de société : avec son visage net, ses cheveux lisses, sa robe jusqu’aux chevilles, personne n’aurait songé à lui manquer de respect. Elle avait envie de parler, le bavardage était pour elle l’un des derniers échos du plaisir. Elle lut les titres des livres qui traînaient partout, Laforgue venait de terminer une année grecque, les livres étaient austères, il y avait sur sa table le Politique, l’Éthique ’à Nicomaque et le Commentaire de Simplicius. Pauline se rassit sur le divan. Sa robe découvrait les grandes plages de soie de ses bas ; elle regardait Philippe avec un sourire à tuer qui voulait en dire long.
— En voilà assez pour aujourd’hui, pensa Laforgue. Nous ne sommes pas complices pour si peu.
— Comme cela doit être passionnant, toute cette sagesse grecque ! s’écria-t-elle.
— À qui le dites-vous, répondit Laforgue.
— Tellement plus qu’une femme comme moi, n’est-ce pas soupira Pauline. Une femme sans importance…
— Aucune comparaison, dit Philippe, qui se dit : elle minaude, c’est un comble. Mais vous me faites penser que j’étais en train de travailler quand vous êtes venue. J’étais dans un de mes bons jours, figurez-vous…
— Ce qui doit signifier, répondit Pauline, que je pourrais peut-être vous débarrasser maintenant de ma présence.
Laforgue haussa légèrement les épaules, mais Pauline sourit : c’était fini, elle était rhabillée, elle savait qu’elle ne pouvait exiger des hommes une reconnaissance passionnée pour ce qu’elle leur donnait.
Laforgue l’accompagna jusqu’à la porte de la rue d’Ulm, elle s’éloigna vers la grille et la loge du portier.
On est vraiment trop poli, pensait-il. Cette fois-ci, j’aurais dû coucher avec cette fille.
Bloyé arriva au pied des marches du porche, il revenait du jardin. Laforgue lui dit, un peu haut.
— Bloyé, tu vois cette dame ? Eh bien, elle ne couche pas. Pauline se retourna et jeta vers eux un regard de colère.
Laforgue se dit en rougissant que l’insulte ne l’empêcherait pas de revenir, qu’elle n’était pas si fière, et il rentra se laver les mains.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IV
À la mi-novembre, les interminables vacances en famille terminées, la Guerre Civile parut, avec la mitrailleuse de Pluvinage, qu’ils avaient finalement adoptée, noire sur la couverture bleue. Ils étaient tous assez fiers d’eux-mêmes à cause de leur nom en capitales dans le sommaire, et de la mitrailleuse de Serge.
Des gens s’abonnèrent ; ils reçurent au bureau de la rédaction, qu’ils avaient installé dans une petite boutique humide et sombre, avec des lampes électriques toute la journée, rue des Fossés-Saint-Jacques, des lettres enthousiastes écrites par des étudiants de Dijon et de Caen ou d’Aix-en-Provence — on s’ennuie tellement en province que le moindre cri lancé à Paris y trouvera toujours des échos — ou par des instituteurs de campagne sentimentaux et critiques, des femmes, des fous, qui leur envoyaient des projets de Paix perpétuelle, des inventions étouffées, des dessins symboliques, les pièces imaginaires et les plaidoyers de procès sans fin, ou des appels déchirants à la Justice : il y avait surtout des vaincus parmi leurs amis inconnus. Il venait aussi des lettres d’insultes ou des lettres sur le ton Jeune-homme-vous-n’avez-pas-honte, parce que la Guerre Civile traduisait assez bien un état naturel de fureur et que ses rédacteurs s’en prenaient nommément à des personnes vivantes et véritablement respectables. Les raisons qu’ils donnaient de ces condamnations, bien qu’elles fussent appuyées sur de grands appareils de philosophie, n’étaient pas toutes rigoureuses ni valides, mais quand on pense que la France avait alors pour grands hommes le président Poincaré, M. Tardieu et M. Maginot, il faut bien dire que leur instinct ne risquait point de les tromper beaucoup.
Le premier souvenir politique de l’équipe remontait à mil neuf cent vingt-quatre. C’était une année qui avait commencé par des morts, par la disparition des symboles ou des acteurs les plus considérables des premières années de la Paix : Lénine était mort en janvier, Wilson en février, Hugo Stinnes en avril. En mai, des élections pleines de lyrisme avaient amené au pouvoir le bloc des Gauches : comme on venait d’en finir avec la Chambre bleu horizon, on croyait que la guerre était définitivement liquidée et qu’on allait tranquillement recommencer le petit glissement régulier vers la gauche où les historiens sérieux voient le secret de la République en trouvant que cette fatalité providentielle arrange bien des choses et permet de dormir sur ses deux oreilles. En novembre, pour plaire à un pays qui n’avait pas fini en cinq mois d’espérer, on décida de transférer le corps de Jean Jaurès au Panthéon, où le mort du mois de juillet quatorze était attendu par la Patrie reconnaissante et ce qui restait des Grands Hommes, La Tour d’Auvergne, Sadi Carnot, Berthelot, le comte Timoléon de Cossé-Brissac et le comte Paigne-Dorsenne.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Rien n’est plus malaisé que l’exploitation méthodique d’un événement du cœur, rien ne s’amortit plus vite que les ondes d’un coup de foudre. Les examens, la paresse, la littérature, la curiosité des femmes, toutes les fausses manœuvres où se disperse la vie difficile des adolescents empêchèrent longtemps Laforgue et ses amis de tirer de ces violents souvenirs du 24 et du 25 novembre toutes les suites pratiques qu’ils devaient comporter : ils ne firent partie pendant des années que de leurs réserves.
On peut juger singulier qu’ils n’aient point été bouleversés par quelques événements des années vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept et vingt-huit : c’est qu’on mesure mal l’état de divertissement où sont ravis tant de jeunes gens qui découvrent à la fois les livres et les femmes. En juillet vingt-cinq, Laforgue promenait le dimanche aux environs de Paris et emmenait danser à Saint-Cloud et à Nogent-sur-Marne une petite vendeuse du faubourg Saint-Honoré qui lui paraissait plus importante que tout ; en mai vingt-six, Rosenthal oubliait tout pour les révélations de l’Éthique. La guerre du Maroc, le soulèvement de Canton, la grève générale anglaise ne furent guère pour eux que les grandes occasions de quelques jours de lyrisme politique : ils signèrent des manifestes qui les engageaient beaucoup moins que leurs parents ne pensaient. L’intérêt qu’ils portaient au monde manquait de précision. L’affaire Sacco et Vanzetti et les grandes assommades de Paris auraient pu jouer dans leur vie un rôle qui les eût plus durement marqués que les cérémonies Jaurès, mais c’était l’époque des vacances, aucun d’eux n’était à Paris, toute l’affaire ne fut qu’une nouvelle qu’ils lurent avec quarante-huit heures de retard dans les journaux, en Bretagne ou dans le midi.
Pendant toutes ces années, ils avaient des périodes de passion, décidaient de se coucher à trois heures du matin : c’était plus qu’il n’en fallait pour passer des examens, c’était un peu mince pour s’oublier. Ils apercevaient une piste et s’y lançaient moins pour s’instruire que par espoir de tomber sur un miroir ou sur une source. Ils découvrirent tour à tour Mendelsohn, le Philosophe inconnu et Rabbi ben Ezra. Au bout de quinze jours, l’humour l’emportait, ils s’éveillaient et retournaient presque chaque soir au cinéma. C’étaient des impatients, mais paresseux.
Cette légèreté ne les empêchait pas de croire à la révolution : ils se souciaient peu de paraître vraiment inconséquents. Ils faisaient parfois des examens de conscience, mais c’était pour conclure qu’ils n’inclinaient point à la révolution par amour de l’humanité, ni par une adhésion rigoureuse aux événements. Il est bien vrai qu’il n’y avait pas la moindre philanthropie dans leur mouvement naturel de révolte : l’humanitarisme leur semblait de bien mauvais aloi et ils ne jugeaient pas que la Révolution fût une renaissance laïque de la chrétienté.
— Ce qui me plaît dans la révolution, disait Laforgue, c’est que la civilisation qu’elle promet sera une civilisation dure.
— D’accord, disait Rosenthal. L’âge de la facilité s’achève… Ils étaient plutôt sensibles au désordre, à l’absurdité, aux scandales logiques, qu’à la cruauté, à l’oppression, et la bourgeoisie dont ils étaient les fils leur paraissait enfin moins criminelle et moins meurtrière qu’imbécile. Son dépérissement et sa condamnation, ils n’en doutèrent jamais. Mais ils ne souhaitaient pas se battre pour les ouvriers, qui heureusement ne les avaient point attendus, mais pour eux-mêmes : ils ne les regardaient que comme leurs alliés naturels. Il y a bien de la différence entre vouloir couler un navire et ne pas consentir à couler avec lui…
Le vif dégoût familial qu’ils éprouvaient de la bourgeoisie aurait pu les conduire à une critique violente mais anarchiste. Mais l’anarchie leur paraissait illettrée et frivole : leurs études de professeurs les sauvaient. Ils méprisaient la génération qui les avait immédiatement précédés pour n’avoir exprimé la révolte que dans des vocabulaires et sous des cautions poétiques : le moment paraissait venu de donner à la colère des répondants philosophiques.
— Entrons dans le genre sérieux, disait Bloyé.
Rosenthal commentait :
— On verra plus tard qu’il s’est produit un changement historique à partir du moment où Hegel et Marx ont détrôné dans les admirations de la jeunesse des Écoles Rimbaud et Lautréamont.
Ils n’aimaient que les vainqueurs et les reconstructeurs, ils méprisaient les malades, les mourants, les causes désespérées : aucune force ne pouvait séduire plus fortement des jeunes gens qui se refusaient à être emportés dans les défaites bourgeoises qu’une philosophie qui, comme celle de Marx, leur désignait les futurs vainqueurs de l’histoire, les ouvriers promis à ce qu’ils considéraient un peu vite comme une fatalité de victoire. Ils se laissaient d’ailleurs aller jusqu’à croire avec une complaisance excessive que la Révolution était faite au moment où ils ne se sentaient décidément plus solidaires de la bourgeoisie, et une sorte d’orgueil satisfait les faisait parler de la conscience post-révolutionnaire ; personne n’aurait songé à les trouver dangereux, ils travaillaient moins à détruire le présent qu’à définir un avenir terriblement contingent.
La Guerre Civile les occupa beaucoup pendant les premiers mois : ils ne se doutaient pas alors que ce qu’il y avait de plus important dans cette aventure, c’est qu’elle leur donnait des occasions de grandes lectures et leur première chance de rapports suivis avec des ouvriers, et qu’ils se souviendraient plus tard, avec l’étonnement que donne le souvenir du bonheur, des heures qu’ils passaient avec des typographes habiles et narquois dans la petite imprimerie de labeur de la rue de Seine où ils allaient corriger leurs épreuves et mettre en pages la revue.
Ils n’étaient pas modestes, ils se comparaient à de célèbres associations, aux Encyclopédistes, aux Hégéliens,
Rosenthal pensait que leur entreprise principale devait être une critique encyclopédique des valeurs et comme la réduction générale des idées à leurs véritables mobiles : aucune recherche ne lui paraissait plus importante que la critique de la mystification et la mise au clair du mensonge ; Laforgue rêvait d’une espèce de généralisation des analyses de Marx sur le fétichisme de la marchandise, d’une caractéristique universelle de la duperie.
On était en effet au lendemain de la guerre et des premiers désordres de la paix ; on sortait d’un temps prodigieusement mensonger où toute l’éducation des adolescents s’était faite au milieu de bavardages solennels qu’avaient tour à tour nourris les nécessités de la conduite de la guerre et le succès des grandes combinaisons de la paix. Ils s’apercevaient qu’ils n’avaient pas été moins dupés au lycée que leurs pères ou leurs frères aînés sur le front. Leurs mères, solitaires et facilement héroïques, comme toutes les femmes des hommes qui mourront dans les guerres, avaient elles-mêmes menti avec une aisance civique qui confond. Dix ans après Versailles, presque tous les hommes qui étaient revenus du front, sauvés au dernier moment par la sonnerie de clairon de l’Armistice, hésitaient encore à dévoiler le sens des inventions rhétoriques pour lesquelles ils avaient combattu : on a rarement le cœur de se désavouer et de crier sur les toits qu’on a cru un jour les menteurs sur parole ; il faut être bien fort pour ces aveux publics, on aime mieux avoir été complice que naïf. On comprendra pourquoi Laforgue et ses camarades ne méprisaient personne plus profondément que les Anciens Combattants. Les voix qui s’étaient élevées après le dernier jour de la guerre paraissaient encore peu nombreuses : elles ne s’imposaient pas aux jeunes gens. Tout dépendait du hasard d’une rencontre qui ne se produisait pas toujours. Laforgue et Rosenthal, à un an près, avaient manqué le mouvement de Clarté, qui se décomposait déjà.
Derrière les volets fermés de la boutique de la rue des Fossés-Sainte Jacques ou dans leurs salles de la rue d’Ulm, ils passaient des heures à agiter ces choses. Des camarades qui ne faisaient pas partie de l’équipe venaient les retrouver ; ils discutaient très tard en buvant du café que Bloyé passait, jusqu’à ce qu’ils fussent ivres de paroles et de fumée. Par exemple, Rosenthal disait :
— Une encyclopédie moderne ne saurait se fonder que sur la sincérité de l’insolence. Personne n’attend de nous autre chose que de l’insolence. Il faut annoncer avec des moyens d’expression suffisamment prophétiques pour bouleverser les bonnes consciences, le déclin de l’époque du mensonge. Une pareille annonciation ne se fera pas sans système : c’est pourquoi notre mission spéciale de philosophes consiste à redonner du ton, et l’accent de notre temps à tous les systèmes déprédateurs, à Spinoza, à Hegel et à Marx… Notre entreprise ressemblera donc plutôt à l’Encyclopédie hégélienne qu’à l’Encyclopédie de d’Alembert qui comporte toutes les tares des compromis bourgeois… Si les gens sont à l’agonie, c’est qu’ils étouffent sous des coquilles de mensonge. Nous leur dirons pourquoi ils meurent, ces Bernard l’Ermite. Ils seront furieux contre nous, personne n’aime la vérité pour elle-même, Marx disait qu’il faut donner aux hommes la conscience d’eux-mêmes, même s’ils ne le veulent pas. Ils n’aiment pas la conscience, ils aiment la mort… Pendant un certain temps, mes amis, nous n’aurons pas d’autre tâche que de déprécier leurs idées et de les déshabituer des flatteries… Il n’y a pas phrase que j’admire davantage que celle de Lénine sur la profanation de l’or, vous vous rappelez ? « Quand nous aurons vaincu à l’échelle mondiale, nous construirons des pissotières en or dans les capitales du monde… »
Laforgue disait alors :
— Ce que je crains un peu, c’est la durée probable de cette mission… Tu sais à qui je nous compare ?
— Non, répondait Rosenthal.
— Je nous compare à cette brillante équipe de Jeunes Hégéliens, dans le genre Bruno Bauer et consorts qui préféraient décidément les révolutions des consciences aux cassages de gueule des révolutions. Tu ne connais pas la petite épigramme sur le Doktorklub ?
Usere Täten sind Worte bis jetzt und noch lange
Hinter die Abstraktion stellt sich die Praxis.
II y a des jours où je me demande s’il ne vaudrait pas mieux coller des affiches sur les murs avec les types d’une cellule…
— C’est du romantisme à rebours, d’une qualité assez basse, répondait Rosenthal. La victoire dans la pensée doit précéder la victoire dans la réalité.
— Voire, disait Laforgue. C’est exactement par là que tu me parais idéaliste. Est-ce que ça ne serait pas que la réalité nous paraît un peu lourde à déplacer ?
— Pas d’accord, coupait Rosenthal. La fonction du philosophe consiste exclusivement dans la profanation des idées. Aucune violence n’égale par ses effets la violence théorique. Plus tard l’action vient…
— Elle vient, disait Laforgue, quand la théorie a pénétré les masses. Crois-tu que ce soit de notre théorie que les masses attendent d’être pénétrées ?
— Nous verrons bien, répondait Rosenthal.
Bernard était pourtant plus impatient que tous les autres, mais rien ne lui paraissait alors plus urgent que de lancer quelques cris, qu’il nommait communément des messages et qui manquaient de simplicité. En décembre et en février, Rosenthal publia dans la Guerre Civile des pages qui n’avaient pas de chances sérieuses d’ébranler le capitalisme.
V
Ses premiers cris poussés, ses premiers cris écrits, Bernard souhaita l’action.
La Guerre Civile durait depuis trois mois, elle avait cinq cents abonnés et huit cents acheteurs au numéro, trois maisons d’éditions lui donnaient de la publicité : c’était beaucoup, c’était un succès, mais on ne pouvait pas dire que ce fût un bouleversement historique de la pensée française. Parler de la colère ou de la dépréciation des valeurs ou des ruses de la Raison bourgeoise, Rosenthal s’en fût sans doute contenté si ces discours avaient entraîné des poursuites, mais avec cette liberté absurde de la presse, le Procureur de la République ne bougeait toujours pas : il était impossible de prendre pour un geste l’exercice de la philosophie.
Le printemps allait arriver. On venait de traverser des mois sévères, mais les glaces fondaient, l’hiver mourait dans les averses ; on avait envie de se lever tôt, les jours allongeaient comme ces plantes qu’on voit grandir, se déplier en tremblant sur l’écran des cinémas. Rue de la Paix, les midinettes sortaient en bandes et traversaient la place Vendôme et la rue de Rivoli en se donnant le bras. De temps en temps, il faisait beau, comme si des journées d’été, d’automne ou du dernier printemps qui, étouffées par la pluie, par un orage, n’avaient pas fait leur apparition des mois plus tôt, versaient leur chaleur sur des mains encore engourdies, des lèvres encore gercées. Il y avait encore des gelées blanches sur les pelouses du Luxembourg, mais entre deux giboulées, on retrouvait le ciel.
À part ce printemps qui montait, c’était une mauvaise époque pour des jeunes gens impatients. Les choses avaient l’air en général de se calmer, dans l’économie, dans la politique. Il y eut un moment où l’histoire de l’Europe parut étale comme la mer en temps de morte eau, où on oublia la guerre et la paix, la Ruhr, le Maroc et la Chine. La saison de Deauville ne fut jamais plus, brillante que cette année-là et on en reparlait encore pendant l’été trente-sept qui ne fut pourtant pas mal au point de vue courses et casinos. Chez les parents de Rosenthal, des dames qui avaient eu leur belle époque vers la mobilisation qui n’est pas la guerre disaient :
— Vous ne trouvez pas, chère amie, que ce printemps a comme un petit goût d’avant-guerre ?
Il ne se passait en effet pas grand’chose. L’Affaire de la Gazette du Franc amusait plutôt le monde, le président Poincaré avait des majorités de cent voix, avec le pacte Briand-Kellogg, on allait peut-être se sentir un peu tranquilles. Il y avait bien quelques grèves, mais Halluin et le textile du Nord étaient loin, et la grève des taxis était en somme bien agréable pour les voitures privées qui pouvaient enfin circuler dans Paris. On se serait peut-être ému des trente morts de l’Armée du Rhin au mois de mars. Comme c’est affreux, ces épidémies qui fauchent à la saison des giboulées les petits soldats dans des pays lointains, moins lointains que l’Indochine ou que Madagascar, mais tout de même bien loin des mères ! Là-dessus le maréchal Foch était mort, le même mois que les soldats de l’Armée du Rhin auxquels on avait un peu moins pensé. Quelle occasion d’aller faire la queue au bout de la rue de Grenelle, en plein faubourg Saint-Germain, avec des Anglais, des nurses du Champ-de-Mars, de vieilles dames et des prêtres pour voir à quoi ressemble le deuil des familles illustres, et les vieux maréchaux vainqueurs s’établir dans la mort avec leur mentonnière ! Mais en avril, quand des soldats fraternisèrent dans le Gard avec les mineurs en grève qu’ils avaient pourtant pour consigne d’écarter des puits, les gens en eurent par-dessus la tête de toutes ces histoires de militaires où il n’y avait vraiment que les maréchaux de possible, et encore. Enfin, les dames se sentaient rassurées, c’étaient les mêmes qui devaient parler quelques années plus tard de l’avant-crise comme elles avaient parlé en vingt-huit de l’avant-guerre et à qui l’on entendait dire dans les salons qu’à la dernière guerre on leur avait pris leurs fils et que pour la France passe encore, mais qu’à la prochaine guerre on leur prendrait aussi leur argent : elles avaient besoin d’être tranquillisées. Heureusement, le préfet Chiappe montra cette année-là qu’avec lui l’ordre ne risquait rien et on se dit qu’après le 1er mai et le 1er août, les communistes en avaient pour longtemps avant d’avoir pansé toutes leurs blessures.
Un soir, vers la fin du mois de mars, rue d’Ulm, Rosenthal s’écria que la Révolution exigeait d’eux beaucoup plus que des articles.
— On écrit, dit-il, et on croit que la Révolution est faite. On tombe, — nous tombons — dans les fantaisies post-révolutionnaires. Vous êtes satisfaits ? Oui ou non ? Vous ne dites rien ? La confiance dans la révolution ne se mesure qu’aux sacrifices qu’on lui fait et aux risques qu’on court pour elle…
— C’est à peu près ce que j’ai toujours eu l’honneur de te dire, répondit Laforgue.
Le lendemain, Bloyé dit à Laforgue :
— Voilà quatre mois que la revue dure, c’est bien long… Rosenthal doit avoir des idées de derrière la tête. On lui voit cette satisfaction hypocrite des hommes qui font des plans…
Oui, dit Laforgue. Il se chante sournoisement une nouvelle chanson.
Ses amis attendaient pourtant : ils connaissaient son goût du mystère, des coups de théâtre, ils ne l’interrogeaient pas.
VI
Un samedi, vers le soir, ils reçurent tous un pneumatique qui les priait de se trouver le lendemain à deux heures en face de Saint-Germain-des-Prés, tous : Laforgue, Bloyé, Jurien et finalement Pluvinage.
Il n’existe point de groupe de jeunes gens où ne s’établissent des hiérarchies, des distances, comme si quelques-uns d’entre eux recevaient de tous les autres le crédit d’un plus vaste avenir. Rosenthal qui faisait figure de chef et se plaisait à cette dignité, se défiait vaguement de Pluvinage, il avait hésité à le convoquer : il ne lui aurait pas confié ses secrets. Peut-être était-ce à cause de son nom : on ne s’appelle pas Pluvinage. Mais la journée ne promettait pas d’être fertile en grands mystères, Bernard avait tout de même averti Pluvinage.
— Tu es un rude salaud, dit Bloyé, tu aurais bien pu monter jusqu’à la rue d’Ulm avec ton corbillard.
— Montez, dit Rosenthal. Nous n’allons pas tout près.
— Peut-on savoir où nous partons ? demanda Laforgue.
— Tu verras bien, répondit Rosenthal, en embrayant.
Aucun d’eux n’insista : ils n’avaient pas encore perdu le goût des jeux dont on n’a pas la clef.
L’auto sortit de Paris par l’avenue de Neuilly et la route de la Défense ; à Argenteuil, qu’ils abordèrent par les quais, des batteries de cheminées d’usine se dressaient derrière le rideau de pluie au-dessus des prairies plates et rebroussées par le vent ; des vapeurs acides traînaient partout dans l’air râpeux du dimanche ; passé Argenteuil, passé Bezons, ils franchirent une seconde fois la Seine sur le pont de Maisons-Laffite et tournèrent ensuite du côté de SaintrGermain. Un peu avant Mesnil-le-Roi, la voiture s’arrêta en grinçant de tous ses tambours devant une maison ancienne bâtie dans cette pierre de taille un peu tendre qu’on rencontre assez tôt sur les routes du Vexin. La pluie venait de cesser, les branches encore noires, à peine bourgeonnantes après l’interminable hiver, les glycines au-dessus de la grille s’égouttaient. Rosenthal sonna à la porte de fer ; une jeune femme sortit sur le perron et leur cria d’entrer, et ils poussèrent la porte du jardin.
— Bonjour, Rosenthal, vous allez bien ? demanda la jeune femme. Vous n’avez pas eu peur de toute cette pluie ?
— Pas question, répondit Bernard, C’était même plutôt agréable. Simone, voici les amis dont je vous ai parlé.
— Je suis sûre que François va être ravi de les connaître, dit-elle.
— Elle leur serra la main, longuement, en les regardant dans les yeux d’un regard un peu myope. Elle était blonde, fardée et assez maigre, sa main avait des os d’une petitesse et d’une sécheresse inquiétantes. Ils entrèrent ; des flaques d’eau se formèrent aussitôt sous leurs imperméables. Dans la salle à manger, il y avait des housses au crochet, des abat-jour, des assiettes à légendes sur les murs, un tapis vert passé, brodé de fleurs jaunes, sur une table ronde où des tas de revues et de journaux traînaient. La jeune femme surprit leurs regards.
— C’est assez sordide, n’est-ce pas, dit-elle. Mais il fallait à François un endroit tranquille pour travailler ; à Parisî il ne peut rien faire avec tous ses rendez-vous et cet horrible téléphone. Je vais vous faire du thé, vous devez être gelés…
— Elle sortit, ils entendirent remuer des tasses, ils s’approchèrent du feu de bois qui brûlait au fond de la cheminée de marbre noir.
— Qu’est-ce que c’est que cette dame ? demanda Laforgue, et de qui parle-t-on ?
— Vous êtes chez un de mes amis, répondit Rosenthal. Il va descendre.
— La jeune femme revint. Ils attendirent encore quelque temps en buvant dans des verres du thé avec des ronds de citron.
— Est-ce que vous aimez au moins le thé à la russe ? disait-elle.
La conversation tomba. Ils entendaient marcher de long en large au-dessus de leurs têtes.
— Quand François travaille, dit la jeune femme, il est comme un lion en cage… Je l’ai prévenu que vous étiez là.
Ils s’ennuyaient un peu, mais enfin pour un dimanche d’avril. À travers les vitres, ils découvraient la vallée de la Seine qui virait au pied des terrasses de Saint-Germain et sur l’horizon brouillé, une province de toits rouges tombés au hasard de la plaine et des routes jusqu’aux pentes du Mont Valérien.
— Vous avez une bien belle vue, dit Bloyé.
— Pour ce que j’en fais ! s’écria-t-elle en croisant ses jambes nues. Rien ne m’embête comme la campagne. Et à cette saison !
Une porte se ferma au premier étage, des pas descendirent l’escalier qui craquait et leur hôte entra ; c’était un homme long, un peu voûté, avec des yeux bleus qui se déplaçaient avec une mobilité si grande qu’on croyait parfois qu’il louchait, et un front nu qui lui donnait un air légèrement égaré.
— J’ai vu cette tête-là quelque part, pensa Laforgue. Cette bouche molle…
— Régnier, dit Rosenthal, permettez-moi de vous présenter mes amis. Voici Laforgue, Bloyé, Jurien, Pluvinage…
Régnier leur serra la main : ils connaissaient tous son nom, ils avaient lu ses livres, c’était le premier écrivain connu qu’ils rencontraient : ils eurent sur le champ envie de briller, de le contraindre à les admirer. Ce ne fut pas facile, et finalement ils n’y parvinrent pas. François Régnier parla presque tout le temps d’une manière hachée, du temps qu’il faisait, du livre auquel il travaillait et où il était justement question de la jeunesse, et il était tellement content de causer avec eux, de voyages ; il cita des plats espagnols, grecs, c’était à croire que les voyageurs ne quittent point les restaurants.
— À la Barraca, à Madrid, disait-il, on mange un cocido tout à fait extraordinaire… Quand vous irez à Madrid, il faut absolument que vous alliez voir mon vieil ami El Segobiano, qui vous fera une soupe au pain étonnante…
Ou bien :
— À Athènes, chez Costi, on doit manger des palombes rôties. Mais peut-être que le meilleur repas que j’aie fait en Grèce, c’était encore ces œufs sur le plat à l’huile d’olive que j’ai mangés à Eleusis, chez un épicier qui m’expliquait des choses sur la bataille de Salamine.
Ils ne le trouvaient vraiment pas extraordinaire et se sentaient plutôt hargneux à cause de ce ton de supériorité des hommes de quarante ans qui en ont tant vu. De temps en temps, Régnier se levait et marchait autour d’eux.
— François, arrête-toi, dit enfin la jeune femme. Tu nous donnes le mal de mer…
— Simone, répondit-il, donne-moi mon plaid. On crève dans cette maison.
Il jeta sur ses épaules un plaid écossais et ne se rassit pas. Il posa aux jeunes gens des questions sur eux-mêmes, sur les idées qu’ils se faisaient de l’amour, de la politique ; ils répondirent évasivement : de quoi se mêlait-il ? Il cita des phrases d’hommes célèbres, il avait l’air de connaître tout Paris :
— Herriot me disait la semaine dernière, commençait-il, « Mon petit Régnier… »
Ou ;
— Philippe Berthelot me racontait que le jour de la signature du pacte Briand-Kellogg…
Le nom de Platon lui inspira à propos de la peinture, à laquelle justement Berthelot n’avait jamais rien compris, une variation brillante, mais que ces spécialistes qui sortaient du Sophiste et du Politique jugèrent fausses : Bloyé le lui expliqua avec une certaine raideur insolente, ils n’étaient pas fâchés de prendre en faute tant d’odieuse aisance, de montrer à Régnier que s’il connaissait Berthelot, Herriot, Léon Blum, du moins il ignorait Platon.
— C’est bien possible, répondit-il, en riant d’une manière négligente, en montrant ses dents. Depuis le temps que j’ai expliqué la République à la Sorbonne, avant la guerre ! Cela n’a d’ailleurs aucune espèce d’importance. Quand vous aurez mon âge, vous vous moquerez du respect des textes.
Il continua à leur expliquer la peinture, qui jouait dans ces années-là le rôle que le théâtre avait rempli vingt ans plus tôt, et comme il citait des noms de peintres qu’ils ne connaissaient pas, ils le trouvèrent grossier. Un peu plus tard, il leur demanda :
— Quel âge avez-vous tous ?
— Vingt-deux ans.
— Vingts trois.
— Vingt-trois.
— Rosenthal, je sais, dit Régnier.
— Et vous ? demanda Laforgue.
— Trente-huit, dit-il. Sont-ils jeunes !
Régnier se mit à rire une seconde fois de son rire déplaisant.
Vers cinq heures et demie, ils partirent. Il faisait tout à fait nuit ; sous un plafond de nuages, un immense fouillis de lumières clignotantes s’étendait jusqu’au bout de la terre, bien au delà de Paris. Dès que Rosenthal accéléra, sous les arbres pourris de la forêt de Saint-Germain, le froid leur coupa les joues. Le vent sentait la mousse, le champignon et le terreau.
— Qu’est-ce que vous en pensez ? demanda Rosenthal. Comment avez-vous trouvé Régnier ?
— Pas mal, dit mollement Bloyé.
— Excessivement emmerdant, dit Laforgue.
— Il n’était pas en forme, dit Rosenthal. Il ne faut pas le saisir dans un jour de travail, je crains que nous ne l’ayons un peu dérangé, il dit alors n’importe quoi, des choses de la surface. Mais je voulais que vous fassiez sa connaissance, pour plus tard. C’est fait maintenant, vous aurez des occasions de le connaître…
— Ne t’excuse pas, dit Laforgue. Il aurait pu faire un plus sale temps.
Bernard était désolé et il se tut. Mais vers Bougival, il dit soudain, sur un ton de défi :
— Régnier est pourtant l’homme le plus intelligent que je connaisse.
— Pourquoi non ? dit Laforgue. Peut-être qu’il cache son jeu…
Paul Nizan.
 La Revue des Ressources
La Revue des Ressources 

